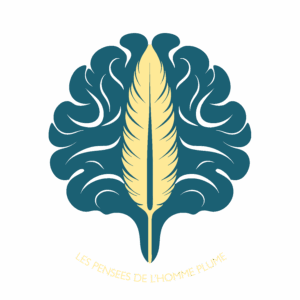CONFUSION ENTRE TROUBLES NARCISSIQUE ET AUTISTIQUE
ANALYSER LES INTENTIONS DERRIÈRE LES COMPORTEMENTS
INTRODUCTION
Après la publication de mon texte sur les relations de dépendance et la synergie entre l’autisme de haut niveau et les personnalités narcissiques, une question récurrente a émergé : peut-on souffrir simultanément d’un trouble narcissique de la personnalité (TNP) et d’un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle (TSA) ?
Je n’ai pas trouvé de documentation scientifique apportant une réponse claire et explicite à cette question. Les études sur cette cooccurrence sont limitées et souvent indirectes, car les recherches se concentrent généralement sur chaque trouble individuellement.
Ainsi, selon le site handicap.gouv.fr, les troubles du spectre de l’autisme (TSA) concernent entre 0,9 % et 1,2 % des naissances en France, soit environ 7 500 nouveaux cas chaque année. La Haute Autorité de Santé estime qu’environ 100 000 jeunes de moins de 20 ans et près de 600 000 adultes sont autistes. De son côté, l’Institut Pasteur indique que les troubles du neurodéveloppement (TND) concernent entre 5 % et 15 % de la population mondiale, l’autisme représentant à lui seul environ 1 %. En 2020, selon une enquête des Centres de prévention et de lutte contre des maladies (CDC), autorité de référence en matière de santé publique aux États-Unis, 1 enfant sur 36 était diagnostiqué comme porteur d’un trouble autistique aux États-Unis, soit 2,78 % de la population générale.
En ce qui concerne le trouble narcissique de la personnalité, une méta-étude épidémiologique a révélé une prévalence médiane de 1,6 % dans la population générale (Morgan TA, Zimmerman M, 2018). Ce trouble semble plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Par ailleurs, les comorbidités avec d’autres troubles, tels que la dépression majeure, l’anorexie mentale ou les troubles liés à l’usage de substances sont fréquentes (Stinson FS et al., 2008).
Pour rédiger le présent texte, je me suis notamment appuyé sur les travaux de plusieurs auteurs et chercheurs. Parmi eux, Randa Ben Romdhane, auteure et créatrice de la chaîne “L’audace d’être soi”, qui vulgarise des recherches internationales sur les troubles narcissiques de la personnalité et leurs effets sur les victimes ; Christel Petitcollin, spécialiste des relations manipulatrices entre personnalités perverses narcissiques et victimes neuroatypiques ; Marie-France Hirigoyen, psychiatre et psychanalyste, reconnue pour ses travaux sur le harcèlement moral et les personnalités toxiques ; et Tony Attwood, psychologue de renommée mondiale, expert des troubles du spectre autistique. J’ai également consulté les chaînes YouTube “Bande d’autistes”, “Dans les yeux d’April”, et l’ouvrage “L’Aspinaute” de Laura Bresson, qui abordent la vie quotidienne sous le prisme de l’autisme. Leurs approches diversifiées permettent de traiter ce sujet sous différents angles et ouvrent de nouvelles pistes de réflexion.
Sur la base de ces documents, il m’apparait que, bien que le trouble narcissique de la personnalité (TNP) et le trouble du spectre autistique (TSA) soient des conditions distinctes présentant des caractéristiques et des motivations différentes, il est possible qu’ils coexistent parfois chez un même individu. Les personnes atteintes de TNP rencontrent souvent des difficultés à ressentir de l’empathie et cherchent la validation externe, tandis que celles avec un TSA peuvent avoir des problèmes de compréhension des signaux sociaux sans pour autant manquer d’empathie.
Cependant, des traits narcissiques peuvent émerger chez une personne autiste en réponse à des expériences de rejet ou d’anxiété sociale. Ainsi, bien que la cooccurrence de ces deux troubles soit peu probable, elle n’est pas impossible et nécessite une évaluation clinique approfondie pour adapter les interventions thérapeutiques.
Toutefois, les traits fondamentaux des deux troubles semblent rendre cette cooccurrence peu fréquente : alors que le TNP est souvent caractérisé par une recherche d’admiration et un manque d’empathie, le TSA se manifeste par une rigidité dans les comportements et une difficulté à saisir les nuances des interactions sociales.
De plus, les personnes atteintes de TSA, notamment celles présentant un autisme sans déficience intellectuelle, ont tendance à exprimer leurs pensées de manière très directe, ce qui contraste fortement avec la manipulation émotionnelle souvent observée chez ceux qui souffrent de TNP.
Ainsi, la nature même de ces troubles semble les opposer l’un à l’autre, rendant leur coexistence chez une même personne particulièrement complexe.
I. L’AUTISME SANS DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
Franchise brute et maladresse sociale
L’autisme sans déficience intellectuelle se caractérise souvent par des difficultés dans la communication sociale et une franchise dénuée de filtres.
Les personnes concernées ne manquent pas d’empathie, mais elles peinent à l’exprimer de manière conforme aux conventions sociales. En d’autres termes, elles possèdent souvent une empathie émotionnelle profonde, mais une empathie cognitive déficiente, ce qui signifie qu’elles ne perçoivent pas toujours l’impact de leurs paroles ou de leurs actions sur les autres.
Lorsqu’une personne autiste réalise qu’elle a blessé autrui, elle peut éprouver un profond sentiment de catastrophisme, même si elle ne comprend pas toujours pourquoi ses paroles ont eu cet effet. Cette réaction est due à une prise de conscience soudaine du décalage entre son intention de sincérité et la perception que les autres ont de son comportement. Pour elle, la franchise est perçue comme une valeur essentielle, un moyen d’établir une communication authentique.
Cette dissonance entre son intention et la réaction des autres peut également conduire à des crises de décompensation violente (« melt-down »), voire de rage, souvent liées à la frustration ressentie face à des malentendus ou à des situations où elle se sent incomprise.
Imaginons une personne autiste sans déficience intellectuelle qui travaille en équipe sur un projet. Lors d’une réunion, elle exprime son avis de manière très directe : “Je pense que ton approche est complètement inefficace et que nous devrions changer de stratégie.” Dans ce cas, le commentaire peut être perçu comme blessant ou dévalorisant par ses collègues, qui pourraient interpréter ce manque de délicatesse comme une tentative de domination ou de manipulation, typique d’un trouble narcissique de la personnalité (TNP).
Cependant, pour la personne autiste, l’intention n’est pas de rabaisser ses collègues, mais plutôt d’apporter une critique constructive, motivée par un désir d’atteindre un meilleur résultat pour le groupe. Elle ne comprend pas toujours que ses mots peuvent être perçus comme une attaque personnelle, car elle privilégie l’honnêteté et la clarté dans ses échanges.
Un autre exemple peut illustrer cette dynamique : une personne autiste de haut niveau est en train de discuter avec son partenaire qui vient de lui confier une profonde tristesse après une dispute avec un ami. Plutôt que de répondre avec des mots réconfortants comme “Je comprends ce que tu ressens” ou “Je suis là pour toi”, elle pourrait dire : “Tu sais, tu as juste besoin de t’affirmer. Si cet ami ne t’apprécie pas pour ce que tu es, peut-être devrais-tu reconsidérer cette relation.”
Cette réponse, bien que motivée par un désir d’encourager son partenaire à se défendre, peut sembler insensible ou dévalorisante. Son partenaire pourrait interpréter cette franchise comme un manque de compassion, ce qui pourrait être perçu, une fois encore, comme une forme de manipulation émotionnelle, semblable à un comportement typique d’une personne ayant un trouble narcissique de la personnalité (TNP). Pourtant, l’intention de la personne autiste n’est pas de blesser, mais plutôt de faire réfléchir son partenaire sur sa situation. Elle ne saisit pas toujours l’impact émotionnel de ses mots ni l’importance d’une réponse empathique dans un moment de vulnérabilité.
Les normes sociales et les conventions de communication peuvent sembler hypocrites ou superficielles aux yeux des personnes autistes, qui privilégient l’honnêteté directe.
Cela peut les amener à éprouver de la frustration face à ce qu’elles perçoivent comme un manque de transparence dans les interactions sociales. Ainsi, le défi réside dans la navigation entre leur besoin d’authenticité et la compréhension des attentes sociétales souvent implicites qui régissent la communication interpersonnelle.
De plus, les personnes autistes sans déficience intellectuelle ont souvent tendance à suivre des schémas de pensée et de comportement rigides. Ce besoin de structure et de routine représente une réponse à l’incertitude qu’elles perçoivent dans le monde qui les entoure. Si une modification survient dans la planification de leur journée, cela peut provoquer une grande anxiété et les désorienter. Cette rigidité comportementale peut, à tort, donner l’impression qu’elles cherchent à contrôler leur environnement ou les autres.
Dans leurs interactions avec leurs proches, cela peut entraîner des malentendus et des frustrations. Par exemple, un partenaire ou un ami peut se sentir blessé par une insistance sur des rituels précis, interprétant cela comme une forme de rejet ou d’inflexibilité. De même, au travail, leurs collègues peuvent percevoir cette rigidité comme un manque de coopération ou d’adaptabilité, ce qui peut compliquer les dynamiques d’équipe.
De ce fait, il est important de comprendre que ce besoin de prévisibilité constitue un mécanisme de sécurité pour elles, et non une tentative de domination. En réalité, leur désir de stabilité peut aussi être un atout, apportant une rigueur et une constance appréciées dans des environnements professionnels ou personnels.
II. DIFFÉRENCE ENTRE LA SYNCHRONISATION PAR SURADAPTATION ET LE MIRRORING
La synchronisation par suradaptation, souvent observée chez les personnes autistes sans déficience intellectuelle, consiste à adopter les comportements et les attitudes des autres pour s’intégrer dans des situations sociales complexes. Ce mécanisme est souvent un moyen de survie social, une tentative sincère de comprendre et d’imiter les normes et les codes qui ne leur viennent pas naturellement. Cette suradaptation n’est pas manipulative : elle découle d’un besoin profond de connexion et d’acceptation dans un monde qui semble difficile à appréhender.
Ce processus, souvent inconscient, en particulier chez les personnes non diagnostiquées, peut être épuisant émotionnellement et mentalement pour les autistes, car il implique de masquer son véritable soi pour éviter les malentendus ou le rejet.
En revanche, le mirroring chez une personne ayant un trouble narcissique de la personnalité (TNP) est intentionnel et calculé. Ici, il ne s’agit pas d’un effort pour s’adapter, mais plutôt d’une stratégie perverse visant à séduire et contrôler autrui. Le narcissique observe attentivement son interlocuteur et imite ses émotions, ses intérêts et ses comportements pour créer un lien artificiel de confiance. Ce processus de mirroring sert à satisfaire ses propres besoins d’admiration et de validation.
Contrairement à la suradaptation autistique, dont l’objectif est l’intégration sociale sincère, la personne narcissique utilise ce mimétisme pour exploiter les autres à son avantage, sans réelle intention de se connecter de manière authentique.
Ainsi, alors que la synchronisation autistique est un acte de traduction intérieure des normes sociales, une tentative de survie dans des environnements perçus comme étrangers, le mirroring narcissique est un masque ajusté sur autrui, un outil de manipulation destiné à renforcer pouvoir et contrôle. La différence clé réside dans l’intention : l’autiste cherche à comprendre les codes implicites pour être accepté, tandis que la personne narcissique souhaite assujettir.
III. POINTS DE CONVERGENCE APPARENTE ET
DIVERGENCES PROFONDES
Pourquoi cette confusion entre ces deux profils ? Certains traits autistiques peuvent, à tort, être perçus comme des signes de troubles de la personnalité narcissique. Cette erreur d’analyse repose souvent sur une lecture superficielle ou inexacte de ce qui relève du TSA. Pour affiner la compréhension de ces attitudes, il est essentiel d’explorer trois axes de lecture qui permettent une approche plus nuancée.
a. Empathie perçue vs réelle
Les personnes autistes sans déficience intellectuelle peuvent sembler indifférentes aux émotions des autres, car elles ne saisissent pas toujours les signaux émotionnels de leur entourage.
Toutefois, chez la personne autiste, le manque d’empathie est avant tout cognitif : il s’agit d’une difficulté à saisir la perspective d’autrui, sans intention de nuire. À l’inverse, la personne présentant un trouble narcissique comprend parfaitement les émotions des autres, mais les exploite à des fins égoïstes, voire destructrices.
b. Rigidité comportementale vs contrôle intentionnel
Les autistes peuvent adopter des routines strictes pour apaiser l’anxiété générée par un environnement imprévisible. Ce besoin de structure, parfois perçu comme un désir de contrôle, est en réalité un mécanisme d’adaptation visant à préserver leur équilibre. À l’inverse, une personne présentant un trouble narcissique cherche délibérément à soumettre son entourage, ajustant ses comportements dans le but de maintenir une position de pouvoir.
c. Communication directe ou manipulatrice
Les autistes sans déficience intellectuelle sont souvent perçus comme brutalement honnêtes. Leur manque de filtre peut choquer, mais leur intention n’est, en général, pas de nuire. La personne ayant un trouble narcissique, quant à elle, manipule consciemment ses paroles pour faire douter, blesser et affaiblir.
IV. IMPLICATIONS POUR LA COMPRÉHENSION
SOCIALE ET LA THÉRAPIE
La clé pour distinguer ces deux profils réside dans l’intention. La personne ayant un trouble narcissique agit pour servir ses propres intérêts au détriment des autres, tandis que l’autiste, malgré ses maladresses, cherche simplement à s’intégrer dans un monde qu’il peine à comprendre.
Avant de juger trop rapidement un comportement “atypique”, il est essentiel de prêter attention à la motivation sous-jacente. La franchise sans filtre d’une personne autiste sans déficience intellectuelle est rarement une attaque personnelle, mais plutôt une expression honnête, quoique maladroite, de la réalité telle qu’elle la perçoit. À l’inverse, la personne narcissique calcule et orchestre ses interactions pour maximiser son contrôle sur les autres.
a. Importance de l’évaluation clinique
Une évaluation clinique approfondie est essentielle pour comprendre les nuances entre le TNP et le TSA. Les praticiens doivent être formés pour identifier les comportements et les motivations sous-jacentes spécifiques à chaque condition.
Un diagnostic erroné peut non seulement entraîner des traitements inappropriés, mais aussi exacerber les symptômes des deux troubles. Une personne autiste peut, par exemple, être à tort perçue comme présentant des traits narcissiques, ce qui renforce la stigmatisation et accroît le sentiment de rejet. D’où l’importance, pour les thérapeutes, d’adopter une approche individualisée qui tient compte de l’histoire personnelle et des expériences de vie de chaque patient.
b. Stratégies d’intervention adaptées
Pour les personnes autistes, des interventions adaptées peuvent considérablement faciliter la lecture du monde social et atténuer l’anxiété qu’il génère.
L’enseignement explicite des compétences relationnelles, débarrassé des implicites souvent sources de confusion, permet de mieux décoder les dynamiques interpersonnelles. De même, une thérapie cognitivo-comportementale personnalisée, respectueuse du rythme et du fonctionnement de chacun, peut offrir un espace sécurisant pour explorer les interactions, travailler les scénarios sociaux, et renforcer un sentiment de légitimité et de compétence dans les échanges. Ces approches, lorsqu’elles sont bienveillantes et non normatives, ne visent pas à “corriger” la personne, mais à lui permettre d’habiter plus sereinement un monde qui ne parle pas toujours son langage.
Chez les personnes présentant un trouble narcissique de la personnalité, l’entrée en thérapie est souvent plus difficile, car elle suppose une remise en question que leur fonctionnement rend rare.
En théorie, certaines approches — comme la TCC ou la thérapie analytique — peuvent aider à déconstruire des schémas relationnels dysfonctionnels, mais cela nécessite un engagement sincère, souvent absent.
c. Sensibilisation et éducation du public
Il est impératif d’accroître la sensibilisation et l’éducation du public concernant les différences entre le TNP et le TSA.
Des campagnes de sensibilisation aideraient à briser les stéréotypes entourant ces conditions. Une meilleure compréhension de ces troubles permettrait non seulement d’améliorer la qualité de vie des personnes touchées, mais aussi de favoriser des interactions plus empathiques et moins stigmatisantes dans la société.
CONCLUSION
Entre observation et discernement
Pour éviter la confusion entre ces deux profils, il est crucial de prendre du recul et d’observer attentivement les comportements. Là où l’un est maladroit et rigide par nature, l’autre est manipulateur et flexible par intérêt. En comprenant les intentions derrière les actions, nous pouvons éviter les malentendus et mieux appréhender la complexité des interactions humaines.
En somme, la confusion entre le trouble narcissique de la personnalité et le trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle souligne l’importance d’une évaluation précise et d’une compréhension nuancée des comportements humains.
Les professionnels de la santé mentale, les éducateurs et la société dans son ensemble doivent s’engager à reconnaître les différences fondamentales entre ces troubles, tout en valorisant les expériences uniques de chaque individu. En faisant preuve d’empathie et de discernement, nous pouvons non seulement améliorer la vie des personnes qui vivent avec ces troubles, mais aussi enrichir nos propres interactions humaines.