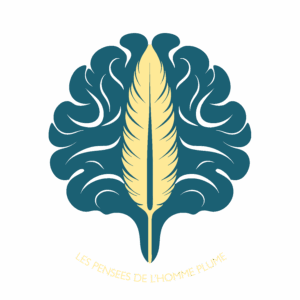COACHING ÉTHIQUE ET TSA
REPÈRES PROFESSIONNELS ET VIGILANCE FACE AUX DÉRIVES
INTRODUCTION
Depuis la pandémie de Covid-19, le coaching en développement personnel — ou coaching de vie — a connu une expansion notable, notamment via les réseaux sociaux.
Cette croissance rapide s’accompagne toutefois d’un flou conceptuel, parfois entretenu sciemment, qui ouvre la voie à des pratiques insuffisamment encadrées.
Certaines d’entre elles relèvent davantage du courant New Age ou de formes de manipulation affective et spirituelle que d’un véritable accompagnement.
Cet article s’adresse à la fois aux personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et aux personnes allistes, tout en soulignant combien il est crucial, pour les premières, de disposer de repères clairs permettant de différencier une démarche authentique d’un coaching potentiellement nuisible.
En effet, les particularités sensorielles, cognitives et relationnelles des personnes autistes peuvent accroître leur vulnérabilité face à des accompagnements inadaptés, voire abusifs (Raymaker et al., 2020).
Lorsqu’il s’inscrit dans un cadre éthique rigoureux et une posture professionnelle clairement définie, le coaching constitue un levier puissant d’émancipation, de consolidation de l’autonomie et de soutien au développement personnel.
Néanmoins, ce champ est également investi par des individus se revendiquant « coachs » sans formation reconnue, ni respect des cadres déontologiques, pouvant générer des situations de confusion, de dépendance ou de manipulation.
L’objectif de cet article est donc d’explorer les critères permettant d’identifier un cadre d’accompagnement éthique, et de proposer des outils de discernement face aux pratiques à risque.
I. RECONNAÎTRE UN PROFESSIONNEL DU COACHING
Critères de compétence et repères de vigilance
Un coach professionnel se distingue d’un expert auto-proclamé par plusieurs éléments fondamentaux : une posture d’accompagnement non prescriptive, une formation reconnue, l’adhésion à un code déontologique, ainsi qu’une pratique supervisée.
Le rôle du coach n’est pas d’apporter des solutions prêtes à l’emploi, mais de soutenir la personne accompagnée dans l’identification et la mobilisation de ses propres ressources.
Des organisations internationales telles que l’International Coaching Federation (ICF) ou l’European Mentoring and Coaching Council (EMCC) ont établi des normes strictes en matière de déontologie, de supervision et de certification.
Ces normes incluent notamment :
– Le respect de la confidentialité ;
– La clarté des limites relationnelles ;
– L’interdiction de toute manipulation ou emprise ;
– L’exigence d’une contractualisation explicite de la relation.
La contractualisation constitue en effet un socle fondamental du coaching professionnel. Ce contrat précise les objectifs, la durée, le rythme, les modalités d’intervention et les responsabilités réciproques. Il offre ainsi un cadre de sécurité indispensable, particulièrement pour les personnes TSA, souvent sensibles à l’ambiguïté relationnelle. Comme le souligne Passmore (2016), la qualité du coaching repose sur un cadre structuré dans lequel transparence, confiance mutuelle et respect des limites sont les piliers d’une relation saine.
Un coach éthique fait également preuve de transparence sur son parcours et ses compétences, accepte d’être supervisé par des pairs, et adapte son accompagnement aux spécificités de chaque personne. Il veille à ne jamais forcer un rythme ou imposer une dynamique incompatible avec les capacités d’intégration du coaché.
Des rapports institutionnels ont mis en évidence les dérives possibles lorsque le coaching est mêlé à des pratiques spiritualistes ou ésotériques, en l’absence de tout cadre professionnel. L’Union nationale des associations de défense des familles et de l’individu victimes de sectes (UNADFI) alerte sur les dangers de ces pratiques non encadrées, notamment dans le milieu de la santé, soulignant que l’absence de régulation peut conduire à des dérives sectaires. De son côté, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES), dans son rapport d’activité 2021, fait état d’une hausse des signalements liés à des formes de coaching mêlant développement personnel et spiritualité, avec un risque accru d’emprise psychologique.
En principe, au cœur de la démarche de coaching réside la notion d’alliance, ce lien spécifique fondé sur la confiance et la co-construction.
Le coach n’est pas un guide qui « sait » à la place du coaché, mais un facilitateur. Il mobilise des outils, des techniques et des questionnements favorisant l’émergence des ressources internes du coaché, dans une logique d’autonomisation progressive.
Cette posture non directive est particulièrement essentielle dans l’accompagnement des personnes TSA. En effet, nombre d’entre elles sont attentives à la cohérence entre les paroles et les actes, aux implicites non verbalisés et à la clarté du cadre relationnel. Une dissonance, même subtile, peut générer méfiance, rupture ou fermeture.
Dans ce contexte, la lisibilité du positionnement du coach, la régularité dans ses propos et comportements, ainsi que la transparence sur les intentions d’intervention deviennent des conditions nécessaires à une relation de confiance durable.
II. DÉRIVES ET CONFUSIONS
Les signes d’un coaching non éthique et les risques d’emprise
À l’opposé des pratiques rigoureuses et encadrées du coaching professionnel, certaines figures autoproclamées se distinguent par l’absence de cadre formel, voire par un refus explicite de contractualiser la relation.
Cette opacité ouvre la voie à diverses formes de manipulation, souvent insidieuses. La tentative d’emprise peut s’exprimer par des projections émotionnelles, du chantage affectif, ou encore par des discours confus, teintés de mysticisme pseudo-spirituel.
a. Entre mysticisme et promesses illusoires – Un cocktail à haut risque
Nombre de ces individus associent des pratiques issues du développement personnel dit « new age » (médiumnité, channeling, soins énergétiques, etc.) à un prétendu coaching. Leur discours s’appuie sur des certitudes absolues, non fondées scientifiquement, et des promesses de transformation rapide ou miraculeuse. Ce flou sémantique et conceptuel nourrit un climat d’incertitude, fragilise la personne accompagnée, et rend quasi impossible l’établissement d’un cadre protecteur.
Ces profils avancent fréquemment un « don » ou un « appel de l’âme » comme légitimité, en lieu et place de toute formation ou certification reconnue.
Leurs présentations évoquent des outils divers et sans lien clair (astrologie, soins « quantiques », libération karmique, constellations, numérologie, massages « tantriques », etc.), sans articulation méthodologique rigoureuse. Le résultat est un accompagnement instable, souvent plus guidé par l’ego du « coach » que par les besoins de la personne coachée.
b. Les signes d’une relation toxique déguisée en coaching
Plusieurs indicateurs permettent de repérer une relation d’emprise sous couvert d’accompagnement :
– Refus de cadre contractuel : absence de contrat, de durée, ou d’objectifs clairement définis.
– Langage flou et répétitif, appuyé sur des « ressentis » ou « intuitions » non vérifiables.
– Projections et jugements implicites, souvent déguisés en constats ou en vérités spirituelles.
– Dépendance induite par un rapport déséquilibré, où le coach prétend détenir un savoir inaccessible au coaché (lecture d’aura, messages d’entités, d’anges ou de guides spirituels désincarnés, etc.).
– Intrusion dans la vie privée, tentatives de contrôle ou commentaires ambigus.
– Épuisement émotionnel, confusion mentale ou sentiment de déstabilisation croissante chez la personne accompagnée.
Pour les personnes autistes, ce type de confusion peut produire des effets somatiques nets : tensions corporelles, douleurs diffuses, troubles sensoriels, repli social, voire début d’un burn-out autistique (Raymaker et al., 2020; Neff, 2021).
c. Quand le discours mystique devient outil de pouvoir
Les affirmations du type « C’est ton ego qui résiste » ou « Tu attires ce que tu vibres » ont pour effet de transférer la responsabilité entière sur la personne en souffrance, sans tenir compte de ses contraintes contextuelles ni de ses spécificités neurobiologiques.
Ces injonctions risquent d’engendrer une confusion cognitive importante, particulièrement chez les populations vulnérables.
Le recours à un vocabulaire pseudo-spirituel, incluant des termes tels que « multidimensionnalité », « éveil des consciences » ou « alignement vibratoire », engendre une impression fallacieuse de profondeur conceptuelle, dissimulant fréquemment l’absence d’une posture professionnelle rigoureuse. Certaines de ces pratiques peuvent constituer des formes de gaslighting, à savoir la contestation de la réalité subjective du coaché sous le prétexte d’un supposé « travail intérieur », ce qui s’avère fondamentalement incompatible avec les principes éthiques de l’accompagnement.
En ce sens, une enquête réalisée par France Inter en 2018 met en exergue les dérives au sein du secteur du coaching, indiquant que 10 à 20 % des signalements annuels adressés à la Miviludes concernent des pratiques de coaching dépourvues d’éthique.
Ces constats suggèrent que les discours culpabilisants et les méthodes employées peuvent non seulement ignorer les réalités neurobiologiques de la souffrance, mais aussi contribuer à l’isolement et à la stigmatisation des individus concernés.
d. Confusion des genres et perte de repères méthodologiques
Les dérives les plus manifestes surviennent lorsque certains praticiens amalgament sans discernement des pratiques telles que les constellations familiales, l’astrologie, la numérologie et la guidance intuitive, sans expliciter les fondements théoriques ni les limites méthodologiques pro- pres à chacune de ces approches.
Cette confusion disciplinaire engendre une zone d’opacité qui compromet la clarté et la légitimité de la posture professionnelle du praticien.
Nous l’avons dit, le discours reste souvent vague, truffé de formules génériques telles que : « accéder à ses mémoires akashiques » ; « se réaligner à sa fréquence originelle » ; « incarner sa mission de vie » ; …
Ce flou lexical, associé à l’absence de supervision, empêche toute évaluation sérieuse de la qualité de l’accompagnement. Il masque également les transferts émotionnels non traités du praticien vers le client, ce qui peut rendre la relation toxique, voire dangereuse.
Par ailleurs, nombre de ces praticiens s’adossent à des structures qu’ils ont eux-mêmes créées de toutes pièces, arborant des intitulés évocateurs tels que « académie », « institut » ou « école », et usurpant les codes de l’enseignement supérieur ou de la formation professionnelle sans en respecter les exigences.
L’usage stratégique de ces dénominations vise à instaurer une illusion de légitimité et de rigueur, alors même que ces entités fonctionnent en autarcie, s’auto-attribuant titres et certifications sans reconnaissance officielle ni validation par des pairs, contrairement aux écoles ou universités reconnues et accréditées par des autorités gouvernementales ou agences indépendantes.
Ce phénomène s’inscrit dans un vide juridique persistant autour du titre de coach, que certains exploitent pour s’adresser à un public vulnérable, parfois en détresse identitaire, notamment parmi les personnes neurodivergentes.
Le risque d’emprise est d’autant plus grand que ces dispositifs entretiennent une rhétorique de transformation radicale, difficilement vérifiable, et rarement encadrée par une supervision éthique ou clinique.
e. Coaching professionnel – Repères et exigences
Par contraste, le coaching éthique repose sur plusieurs piliers essentiels :
– Une formation rigoureuse, certifiée idéalement par un organisme reconnu (ICF, EMCC,…).
– Un cadre contractuel clair, défini dès le début.
– Des objectifs partagés et évaluables.
– Une posture de neutralité bienveillante, sans projection idéologique.
– Une supervision régulière pour prévenir les biais et transferts.
Le Code de déontologie de l’International Coaching Federation (ICF) souligne que l’efficacité du coaching repose précisément sur l’engagement du coach à ne pas imposer ses croyances personnelles.
Ce processus est avant tout collaboratif et centré sur le client, garantissant que l’accompagnement respecte l’autonomie et la singularité de ce dernier, plutôt que de servir la mise en scène ou les convictions du praticien.
Le code encadre strictement cette posture en imposant notamment la confidentialité absolue des échanges (articles 2.1 à 2.4), la transparence sur les qualifications et les compétences du coach (article 5.1), ainsi que la responsabilité éthique de ses actions envers le client, les sponsors, et la société (article 5.3).
Il prévoit également que le coach respecte les limites de sa compétence, évite toute déclaration trompeuse sur ses services (article 5.2), et assume la responsabilité de ses collaborateurs (article 2.6).
Par ailleurs, il offre au client la possibilité de demander à consulter ce code de déontologie, afin de s’assurer du respect de ces engagements et prévenir ainsi toute dérive, notamment celles qui pourraient nuire à la confiance et à la sécurité psychologique dans la relation d’accompagnement.
III. VULNÉRABILITÉS SPÉCIFIQUES
Les personnes neuroatypiques face aux dynamiques d’emprise
Certaines personnes neuroatypiques, notamment celles identifiées comme présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), peuvent se trouver particulièrement exposées à des mécanismes d’emprise, en particulier dans des contextes pseudo-thérapeutiques.
En recherche de repères explicites, de sens, de reconnaissance ou de validation, elles peuvent, selon les situations, confondre lien profond et intrusion, ou percevoir une autorité imposée comme un cadre sécurisant — en particulier lorsque celle-ci se présente sous une forme bien structurée ou dotée d’un discours cohérent.
Plusieurs traits cognitifs, perceptifs ou relationnels fréquemment rencontrés dans le TSA peuvent, dans certains contextes, être instrumentalisés à leur insu :
– Une tendance à une lecture plus littérale du langage, surtout en situation de stress ou de relation ambiguë, peut conduire à interpréter certaines injonctions suggestives comme des exigences implicites. Ainsi, une phrase comme « Tu es prêt à changer ta vie maintenant » peut être vécue comme une injonction pressante plutôt qu’une proposition.
– L’évaluation de la cohérence d’un discours repose parfois davantage sur sa logique interne que sur la vérifiabilité empirique. Cela peut rendre séduisants certains systèmes apparemment structurés, même lorsqu’ils s’appuient sur des prémisses fragiles ou invérifiables.
– Certaines personnes TSA développent une affinité pour les systèmes symboliques (comme les archétypes, les énergies, les représentations yin/yang ou d’autres grilles de lecture du monde) lorsqu’ils leur offrent un cadre explicatif structurant. Cette recherche de sens, si elle est exploitée à des fins de manipulation, peut conduire à une adhésion à des récits qui se présentent comme complets ou révélateurs, sans espace de contestation.
Par ailleurs, la sensibilité fine que peuvent avoir ces personnes à leurs ressentis corporels ou émotionnels peut se brouiller face à des injonctions implicites ou à des affirmations intrusives. Lorsqu’un interlocuteur revendique une « vérité » sur leur être profond, cela peut générer une dissonance entre l’expérience intime et le discours reçu, favorisant confusion émotionnelle et perte de repères sensoriels.
Dès lors, une vigilance adaptée s’impose.
Il ne s’agit pas de développer une hypervigilance anxiogène, mais de s’appuyer sur quelques repères simples, observables et activables à tout moment :
– Le droit de dire non ;
– Le droit de vérifier ou de demander des preuves ;
– Le droit à la pause, au retrait temporaire ;
– Le droit au silence et à la non-réponse immédiate.
Il convient aussi d’interroger certaines pratiques dites « syncrétiques », qui mélangent des éléments issus de traditions diverses sans cohérence méthodologique ni cadre théorique solide.
Une posture se revendiquant comme intuitive, mystique ou « canalisée » peut parfois dissimuler une absence de formation, ou servir de levier d’autorité symbolique. Ce flou est d’autant plus problématique qu’il rend difficile toute remise en question du discours tenu.
Lorsque ces approches prétendent « libérer » des blessures ou des héritages dits « karmiques » profonds à travers des outils non validés, le risque est que le supposé « coach » ou le « praticien » impose ses propres croyances comme des vérités indiscutables. Cela peut déstabiliser certaines personnes autistes, souvent en quête de repères stables et explicites. Cette instabilité — accentuée par une absence de cadre critique ou scientifique — peut nuire à l’autonomie psychique et renforcer une dépendance relationnelle.
IV. ÉCOUTE SOMATIQUE ET SOUVERAINETÉ INTÉRIEURE
Un enjeu de protection pour les personnes autistes
Au-delà des aspects cognitifs ou symboliques, certaines personnes autistes développent une lecture corporelle particulièrement fine de leur environnement relationnel. Pour ces personnes, des zones comme le plexus solaire — centre énergétique souvent associé à la sphère émotionnelle — peuvent servir d’indicateur subjectif de la qualité d’une interaction.
Des sensations telles que brûlures, crispations, tremblements, nausées, ou au contraire un relâchement profond, peuvent alors être interprétées comme des signaux de déséquilibre ou d’alignement.
Ces perceptions, bien qu’individuelles, peuvent s’avérer utiles dans des processus de régulation émotionnelle, comme l’ont suggéré certains travaux sur l’intégration corps-esprit (Siegel, 2012).
Cette sensibilité somatique est parfois décrite en lien avec la neuroception (Porges, 2011), concept désignant la capacité du système nerveux à détecter des signaux de sécurité ou de menace en dehors du champ de la conscience cognitive.
Chez certaines personnes TSA, cette forme de perception peut se manifester de manière accentuée, offrant une forme de boussole sensorielle dans les interactions. Cependant, elle peut aussi s’avérer plus vulnérable à la saturation ou à la confusion, notamment dans des environnements marqués par des attentes implicites, des injonctions paradoxales ou une communication floue.
Dans ce type de contexte, renforcer une posture intérieure fondée sur la souveraineté personnelle peut contribuer à préserver l’intégrité sensorielle et émotionnelle.
Il ne s’agit pas d’imposer un modèle unique de gestion des émotions, mais d’explorer des pratiques simples et adaptables permettant de restaurer un sentiment de stabilité interne :
– La respiration consciente, avec une attention portée à la détente de la zone abdominale haute ;
– L’ancrage symbolique, par exemple via des visualisations (racines, solidité corporelle) ;
– Le silence intérieur, permettant de suspendre les réponses automatiques face à la pression ou à la provocation.
Lorsque le plexus retrouve un état de détente stable — sans tension ni agitation — cela peut correspondre à un retour à un espace psychique plus serein, voire à un sentiment de présence retrouvée à soi-même. Certaines personnes témoignent alors d’un regain de clarté, de créativité ou d’élan vital. Ce constat, que j’ai pu vérifier par ma propre expérience, rejoint les observations formulées par plusieurs facilitateurs en guérison avec lesquels j’ai pu m’entretenir.
Dans une démarche d’accompagnement, un professionnel respectueux saura reconnaître et respecter ces signaux corporels, sans chercher à les interpréter ou à les instrumentaliser. Il s’abstiendra d’exercer toute pression et veillera à offrir un cadre d’écoute ouvert et non-intrusif. À l’inverse, une posture de contrôle ou de déni de ces ressentis peut conduire, chez une personne sensible à ce niveau, à un épuisement progressif, voire à un effondrement émotionnel proche du burn-out.
V. CONSEILS PRATIQUES
Choisir un coach en toute sécurité
Pour éviter les dérives liées à des pratiques de coaching non professionnelles, plusieurs précautions s’avèrent indispensables.
– Vérifier la formation et les certifications du coach constitue une étape incontournable. Cette vérification peut s’effectuer via les sites officiels d’organismes reconnus, tels que l’International Coach Federation (ICF) ou d’autres instances accréditées au niveau national ou international. Un coach professionnel mentionne volontiers ses diplômes, ses affiliations et ses modalités de supervision ; ses références sont en général facilement vérifiables.
– S’assurer qu’un cadre contractuel clair est proposé est tout aussi essentiel. Ce contrat doit formaliser les objectifs, la durée, la fréquence et les modalités de l’accompagnement. Il protège les deux parties, en garantissant une relation éthique, transparente et sans ambiguïté.
– Écouter ses ressentis corporels et émotionnels constitue une source d’information précieuse, en particulier pour les personnes TSA. Un sentiment récurrent d’apaisement, de clarté ou d’élan constitue un bon indicateur. À l’inverse, des sensations de confusion, d’épuisement, d’oppression ou de malaise doivent alerter sur une possible inadéquation du cadre ou de la relation.
– Respecter son propre rythme est une règle d’or. Un bon coach s’adapte au tempo du coaché, sans jamais imposer d’accélération. Toute pression pour « aller plus vite » ou toute tentative de forcer une prise de conscience doit être considérée comme un signal d’alerte.
– Demander des avis ou recommandations peut éclairer un choix, mais cette précaution ne saurait suffire à elle seule. En effet, la recommandation peut parfois constituer le relais inconscient d’un processus d’emprise, notamment si elle repose sur des critères flous ou émotionnels. Il est donc essentiel de questionner les motivations sous-jacentes : pourquoi ce coach est-il recommandé ? Par qui ? Sur quels critères concrets ?
– Analyser la communication du coach (site, réseaux sociaux, supports de présentation) peut fournir des indices révélateurs. Une présentation sobre, claire, cohérente, une transparence sur les parcours et méthodes, l’existence d’une supervision, ainsi qu’un discours respectueux de la complexité humaine constituent des signes positifs. En revanche, un langage mystique ou dogmatique, une absence de mentions légales, une omniprésence de promesses extraordinaires ou un flou sur les qualifications doivent susciter la méfiance.
Il n’est pas problématique qu’un coach ait une pratique spirituelle personnelle ou professionnelle dans un autre champ (énergétique, par exemple), à condition que ces dimensions ne contaminent pas le processus de coaching lui-même.
Il peut exister des cas légitimes de coaching entre pairs dans une même sphère professionnelle (par exemple, un énergéticien coachant un autre énergéticien pour développer ses compétences), mais cela reste strictement circonscrit à des objectifs définis, sans confusion de posture ni interférence idéologique. Dès que ces limites s’estompent, le risque de dérive augmente considérablement.
Ces repères permettent de préserver, dans la durée, sa sécurité psychique, son intégrité et sa souveraineté dans toute démarche d’accompagnement.
CONCLUSION
Le coaching, entre potentiel et précautions
Le coaching peut constituer un levier précieux de développement personnel, à condition qu’il repose sur des fondements solides : une éthique rigoureuse, des compétences clarifiées et continuellement actualisées, un cadre explicite, ainsi qu’un profond respect de la personne accompagnée.
Pour certaines personnes autistes, dont la perception des dissonances relationnelles peut être particulièrement fine ou instable, ces exigences deviennent d’autant plus importantes.
Distinguer un accompagnement professionnel d’une relation potentiellement déséquilibrée demande souvent une vigilance accrue, une écoute attentive de ses ressentis, et une compréhension fine des frontières entre soutien, influence et pouvoir.
Un coach intègre ne cherche pas à imposer ses croyances, n’invoque aucun savoir exclusif, ne pousse pas à l’adhésion. Il adopte une posture de présence, d’alliance, et veille à maintenir la co-construction au cœur de la relation, sans confusion des rôles.
Chez certaines personnes TSA, les effets de résonance émotionnelle ou sensorielle peuvent activer des dynamiques inconscientes intenses, autant du côté du coaché que du coach.
Ces phénomènes ne sont pas pathologiques en soi, mais ils nécessitent un cadre stable, clair, et adaptable. Sans cela, même des intentions bienveillantes peuvent dériver vers des formes d’emprise ou de malentendu relationnel, parfois involontaires.
Il est également important de rappeler que le coaching ne doit pas se substituer à une relation d’amitié, ni combler des besoins affectifs non reconnus. Il ne s’agit ni de thérapie, ni de parentalité symbolique.
Pour des adultes TSA en quête de repères et de soutien, la distinction peut être floue, d’autant plus si le cadre n’est pas solidement posé dès le départ.
Cette question mérite donc d’être pensée, nommée, et contenue par une posture professionnelle claire.
Le discernement constitue ici un allié central.
Il doit être nourri, affiné, cultivé de part et d’autre.
Dans un paysage où le mot « coaching » recouvre des pratiques extrêmement diverses, renforcer l’exigence éthique, clarifier les postures, et promouvoir la responsabilité partagée entre accompagnant et accompagné apparaît plus que jamais nécessaire.
Enfin, avancer sereinement dans un processus de transformation personnelle implique de pouvoir s’appuyer sur des repères solides : ancrage corporel, esprit critique, droit à la pause, à la vérification, au refus.
Ces éléments ne relèvent pas d’une méfiance généralisée, mais d’un ajustement réaliste aux vulnérabilités possibles — et à la richesse perceptive — de certaines personnes autistes.
Bien encadré, le coaching peut alors devenir un espace respectueux, sécure et potentiellement libérateur.
SOURCES
Ouvrages
Hendrickx, S. (2004). Asperger Syndrome and Employment: What People with Asperger Syndrome Really Really Want. Jessica Kingsley Publishers.
Passmore, J. (2015). Excellence in Coaching : The Industry Guide. Kogan Page.
Porges, S. W. (2024). Notre monde polyvagal – Comment notre stress et nos ressentis nous façonnent. Éditions Quantum Way.
Siegel, D. J. (2012). The Developing Mind. Guilford Press.
Articles scientifiques
Coaching et éthique
Rapports & ressources critiques
Déontologie et rapports officiels
Codes de déontologie
Sources journalistiques