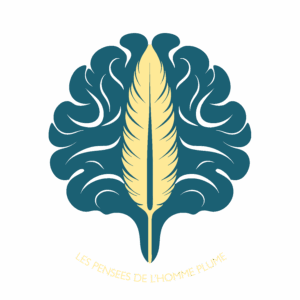L’ÉMERVEILLEMENT AUTISTIQUE
UNE ESTHÉTIQUE DE LA PRÉSENCE
L’émerveillement, lorsqu’il est envisagé depuis une perspective autistique, ne relève pas d’une émotion brève ni d’un surgissement ponctuel face à l’exceptionnel. Il constitue une posture, un mode d’être au monde enraciné dans la sensorialité, l’attention soutenue et une forme singulière de disponibilité à ce qui est.
Là où la société valorise souvent l’émerveillement comme une rupture, un instant de grâce face au spectaculaire ou à l’inattendu, l’expérience autistique, elle, révèle une continuité.
Pour certaines personnes autistes, il ne s’agit pas d’une parenthèse dans le quotidien, mais d’un état perceptif constant, diffus, parfois ontologique.
L’une des caractéristiques fondamentales de cet émerveillement est sa globalité. Il ne se limite pas à un objet remarquable ou à une situation inédite. Il touche tout ce qui advient : une vibration dans l’air, le miroitement de la lumière sur une flaque, le silence chargé d’une conversation, la texture d’un tissu, le rythme d’un pas, le souffle du vent ou le regard d’un chat.
Là où la plupart trient et hiérarchisent les informations perçues selon des critères de fonctionnalité, d’urgence ou de norme sociale, la perception autistique tend à tout accueillir, sans présélection. Cela ne signifie pas un chaos sensoriel, mais une potentialité constante à l’émergence du merveilleux, y compris dans les éléments les plus discrets ou les plus ordinaires.
Cette disponibilité n’est pas seulement cognitive : elle est incarnée.
L’émerveillement autistique s’ancre dans une sensorialité intense, souvent marquée par l’hyperesthésie, parfois amplifiée par la synesthésie — c’est mon cas — ou d’autres formes de perceptions croisées. Un son peut générer une sensation physique dans le thorax, une couleur peut porter une charge émotionnelle vive, un son peut être “trop bleu” ou “irriter la peau”, une ambiance peut se lire dans le corps avant même d’être pensée. Le monde devient un lieu de résonance, où les stimuli ne sont pas abstraits, mais vécus.
Loin d’une contemplation distante, il s’agit d’un engagement sensoriel profond avec ce qui vit, existe ou simplement se présente à nos yeux.
Ce vécu est difficile à verbaliser non en raison d’un déficit langagier, mais parce que l’expérience déborde les structures symboliques habituelles. L’émerveillement autistique touche à l’ineffable — non par mystère, mais par excès de subtilité.
Il ne s’agit pas d’une confusion, mais d’une justesse : une adéquation entre ce qui est perçu et ce qui est ressenti. Le réel, dans sa complexité sensible, est pleinement reçu, traversé, incorporé.
Ce rapport au monde bouleverse les temporalités modernes. Là où la société impose vitesse, rentabilité, anticipation, l’émerveillement autistique ralentit, dilate, suspend. Il propose une autre écologie de la présence. Il ne cherche pas à maîtriser le moment, mais à l’habiter. Être là. Ici. Maintenant. Cette temporalité non productive peut être mal comprise, jugée inefficace, puérile ou “hors sujet”.
Elle est pourtant une forme de résistance à l’appauvrissement des perceptions. Elle rappelle que le réel ne se résume pas à ce qu’on en attend, mais à ce qui nous touche, nous déborde, nous transforme.
Je me souviens d’une remarque qu’on m’a faite un jour : « Ce qui est bien chez toi, c’est que quoi qu’il arrive, tu es toujours content. » Je n’ai jamais su si c’était de l’ironie ou de l’admiration, et n’ai pas cherché à le savoir. J’ai préféré laisser glisser, pour ne pas colorer l’instant d’un ressenti extérieur. C’était une manière de rester aligné avec la joie tranquille qui m’habitait à ce moment-là.
Cette posture, qui peut sembler naïve, est en réalité une responsabilité intérieure : celle de ne pas se laisser désajuster par les projections de l’autre.
Loin d’être une distraction ou un luxe, cet émerveillement constitue pour beaucoup de personnes autistes une nécessité existentielle. Il redonne une valeur aux choses, sans hiérarchie, sans finalité, sans rentabilité. Il rejoint certaines pratiques méditatives ou artistiques, non comme imitation, mais comme mouvement naturel. Il est une manière d’être en relation avec le monde. Une relation qui ne distingue pas strictement entre humain, animal, végétal ou minéral : une pierre peut fasciner, le vent dans les feuilles peut apaiser, une ombre peut émouvoir.
Ce n’est pas un romantisme naïf, mais un art de l’attention. Une attention radicale, où tout — absolument tout — peut être perçu comme digne d’amour, de respect, d’accueil. Ce que l’on nomme souvent « hypersensibilité » relève en réalité d’une hypersignifiance : le monde n’est pas simplement perçu, il est vécu.
Il n’y a pas de cloison étanche entre sujet et objet, mais un va-et-vient constant, une porosité entre l’intérieur et l’extérieur.
L’émerveillement autistique n’est donc pas une étrangeté. C’est une sagesse incarnée, exigeante, vivante. Elle permet de rencontrer l’autre pour ce qu’il est et pour ce qu’il incarne dans le monde — non pas à travers le prisme des projections, des désirs ou des attentes, mais dans une présence nue, accueillante.
Dans un monde qui passe, il invite à rester. Et dans ce temps suspendu — dans ce silence qui précède l’explication — il se pourrait bien que nous retrouvions quelque chose de fondamental : une manière d’être au monde qui ne cherche pas à le posséder ni à le comprendre tout entier, mais à l’honorer.