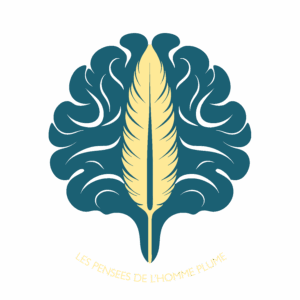LA RIGIDITÉ MENTALE COMME MÉCANISME DE PROTECTION
CROYANCES, CADRE ET CONFUSION IDENTITAIRE CHEZ LES PERSONNES TSA AVEC UN HPI
INTRODUCTION
Il arrive que certaines relations, pourtant marquées par la bienveillance, s’interrompent brutalement, sans conflit apparent. Un mot, une tournure, une proposition vécue comme floue, maladroite ou mal ajustée peut suffire à tout faire basculer. L’un des deux se retire, met fin au lien ou prend ses distances, souvent sans explication claire. L’autre, souvent sidéré, reste avec un sentiment d’inachevé, peinant à comprendre comment un lien qui semblait porteur, voire prometteur, a pu s’éteindre aussi soudainement. Ce type de rupture silencieuse, difficile à interpréter, laisse place à l’incompréhension, parfois à la culpabilité, et surtout à une forme de vide relationnel.
Chez certaines personnes autistes à haut potentiel (TSA-SDI avec un HPI), ces ruptures brutales ne sont pas le fruit d’un désintérêt ou d’une volonté de nuire, mais le résultat d’un mécanisme de protection intense. Le lien est rompu non pas à cause d’un désaccord rationnel, mais parce que le système interne — hypersensible à la cohérence, à la clarté, au cadre — perçoit un danger là où il n’y en avait peut-être pas.
Comprendre ces dynamiques permet non seulement de mieux accompagner les personnes concernées, mais aussi de nourrir une intersubjectivité plus stable et consciente. C’est l’objet de cet article.
Je précise qu’à ma connaissance, il existe peu de littérature scientifique spécifiquement dédiée à cette question ; l’hypothèse que je développe ici repose donc exclusivement sur mes propres observations et réflexions.
I. HYPERSENSIBILITÉ AU CADRE
Quand la souplesse insécurise
Le cadre relationnel explicite constitue un repère central pour de nombreuses personnes TSA. Il offre une sécurité cognitive en rendant prévisible l’interaction. Or, dans certaines situations de co-construction ou d’accompagnement, le cadre peut évoluer, se négocier, se moduler.
Dans une perspective neurotypique, cette flexibilité est souvent perçue comme une marque de confiance ou d’adaptabilité. Cependant, pour une personne TSA, ce déplacement peut générer un sentiment de perte de repères.
En effet, les personnes TSA rencontrent fréquemment des difficultés avec la théorie de l’esprit (la capacité à comprendre que les autres ont des pensées, intentions et émotions différentes des leurs).
Cette limite cognitive rend plus complexe l’anticipation des changements implicites dans la relation, ainsi que la compréhension des intentions non-dites. Le cadre explicite sert donc à compenser ces difficultés en offrant une structure claire et stable. Lorsque ce cadre devient flou ou modulable sans explication, la personne TSA peut le percevoir comme une trahison implicite ou un brouillage, ce qui déclenche des mécanismes de défense visant à restaurer un ordre clair et prévisible.
II. CROYANCES IDENTITAIRES VS VALEURS ÉVOLUTIVES
Un enjeu de confusion identitaire
L’un des moteurs de cette rigidité est la confusion fréquente entre croyance et valeur. Une croyance est une construction mentale tenue pour vraie, souvent héritée ou forgée en réponse à une insécurité. Elle agit comme un repère rassurant, mais peut être rigide et figée.
À l’inverse, une valeur — un principe ou idéal qui guide nos choix — s’enracine durablement et peut évoluer, notamment grâce à une confrontation douce à l’altérité.
Chez une personne TSA-SDI (avec un HPI ou non) qui ne connaît pas encore bien ses besoins et ses limites, les croyances peuvent prendre la place des valeurs et devenir des éléments d’identité non négociables. Ainsi, remettre en question une croyance — même implicitement, par une tournure de phrase — est perçu comme une attaque existentielle.
Ce n’est plus une opinion qu’on remet en jeu, mais l’image de soi-même. Toute nuance devient une menace. Et la relation, dès lors, vacille.
Cette distorsion illustre une forme de rupture du lien intersubjectif : ce n’est plus l’intention réelle qui est perçue, mais le reflet des propres mécanismes de protection.
III. RIGIDITÉ MENTALE
Une tentative de cohérence narcissique
Plutôt que de considérer la rigidité comme un “trait négatif”, il est plus pertinent de la lire comme une tentative d’auto-cohérence. La personne TSA-SDI cherche, souvent inconsciemment, à préserver une image d’elle-même suffisamment stable pour survivre à l’insécurité relationnelle.
Ce n’est pas tant le besoin de contrôler l’autre ou le contexte qui domine, mais le besoin de maintenir une cohérence interne dans un univers perçu comme imprévisible. Cette rigidité mentale est donc un mécanisme narcissique au sens structurel du terme : elle vise à protéger l’image de soi plutôt qu’à entrer en relation.
IV. RUPTURE BRUTALE
Un court-circuit relationnel
Dans ce contexte, la rupture brutale du lien, sans conflit explicite, révèle une difficulté sur le plan intersubjectif — c’est-à-dire dans la relation entre deux subjectivités : la perception qu’a la personne TSA de l’autre devient biaisée par des mécanismes de projections et de protection. La rupture agit alors comme un court-circuit, un arrêt d’urgence de la machine relationnelle.
L’autre n’est plus perçu comme un interlocuteur, mais comme un déclencheur de malaise. Et la fuite devient la seule issue perçue comme sécurisante. Ce n’est pas une fermeture rationnelle, mais une déconnexion émotionnelle.
Ainsi, la personne TSA peut parfois clore le lien par une formule se voulant mature (« Je respecte ta position »), sans pour autant explorer réellement le vécu partagé.
V. SURINTERPRÉTATION
Distorsion de la réalité relationnelle
Les personnes TSA-SDI avec un HPI disposent souvent d’une grande lucidité sur les intentions d’autrui, mais cette lucidité peut basculer en surinterprétation dès que le stress s’invite. Une expression ambiguë, une tournure floue, une différence de rythme — et le filtre interprétatif se charge.
Le moindre écart devient alors un indice de toxicité, d’inauthenticité ou d’emprise, même sans fondement réel. Le message de l’autre n’est plus perçu pour ce qu’il est, mais pour ce qu’il active dans le système de protection interne.
Ce biais est rarement reconnu comme tel : la personne TSA considère souvent sa lecture comme factuelle, objective, évidente. Toute tentative de nuance est vécue comme une négation de son ressenti… donc comme une attaque supplémentaire.
VI. DE LA RUPTURE À L’APAISEMENT
Vers un assouplissement identitaire
Sortir de ces impasses relationnelles n’est pas impossible. Cela demande un retour à soi — non pour renforcer des croyances erronées et protectrices, mais pour explorer les émotions activées et les besoins qu’elles révèlent.
Cela suppose d’apprendre à repérer le moment où l’on quitte l’espace relationnel pour protéger une image de soi ou une croyance.
Le travail thérapeutique, les approches de supervision ou de coaching spécialisé peuvent aider à :
– distinguer perception et réalité ;
– verbaliser l’inconfort sans accuser ;
– accueillir la nuance dan la relation.
Par exemple, dire :
« Cette tournure me fait douter du cadre, je ressens un inconfort », est très différent de dire :
« Tu m’as mis en danger, c’est de ta faute. »
Le premier ouvre un espace de co-régulation, le second claque la porte.
CONCLUSION
Les personnes TSA-SDI avec un HPI présentent une perception particulière et intense de l’intentionnalité d’autrui, qui peut cependant s’avérer imprécise ou biaisée en raison des difficultés à décoder certains signaux sociaux subtils. Sous l’effet du stress, des mécanismes défensifs inconscients peuvent altérer la perception de l’autre, menant à des réponses relationnelles rigides, au retrait ou à des ruptures abruptes.
Ces comportements ne sont pas des caprices, mais des stratégies de protection face à un monde relationnel perçu comme instable et menaçant.
Ce n’est qu’en explorant cette vulnérabilité et en reconnaissant la part de projection dans certaines réactions que la personne peut progressivement habiter des liens plus souples, justes et durables.
La sécurité relationnelle ne tient pas seulement au cadre extérieur, mais surtout à la capacité de reconnaître ses croyances sans s’y identifier, et de rester en lien même lorsque l’autre voit les choses autrement.