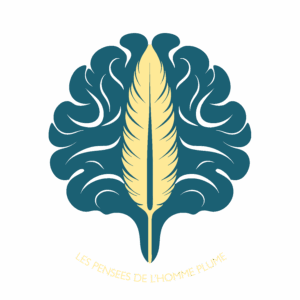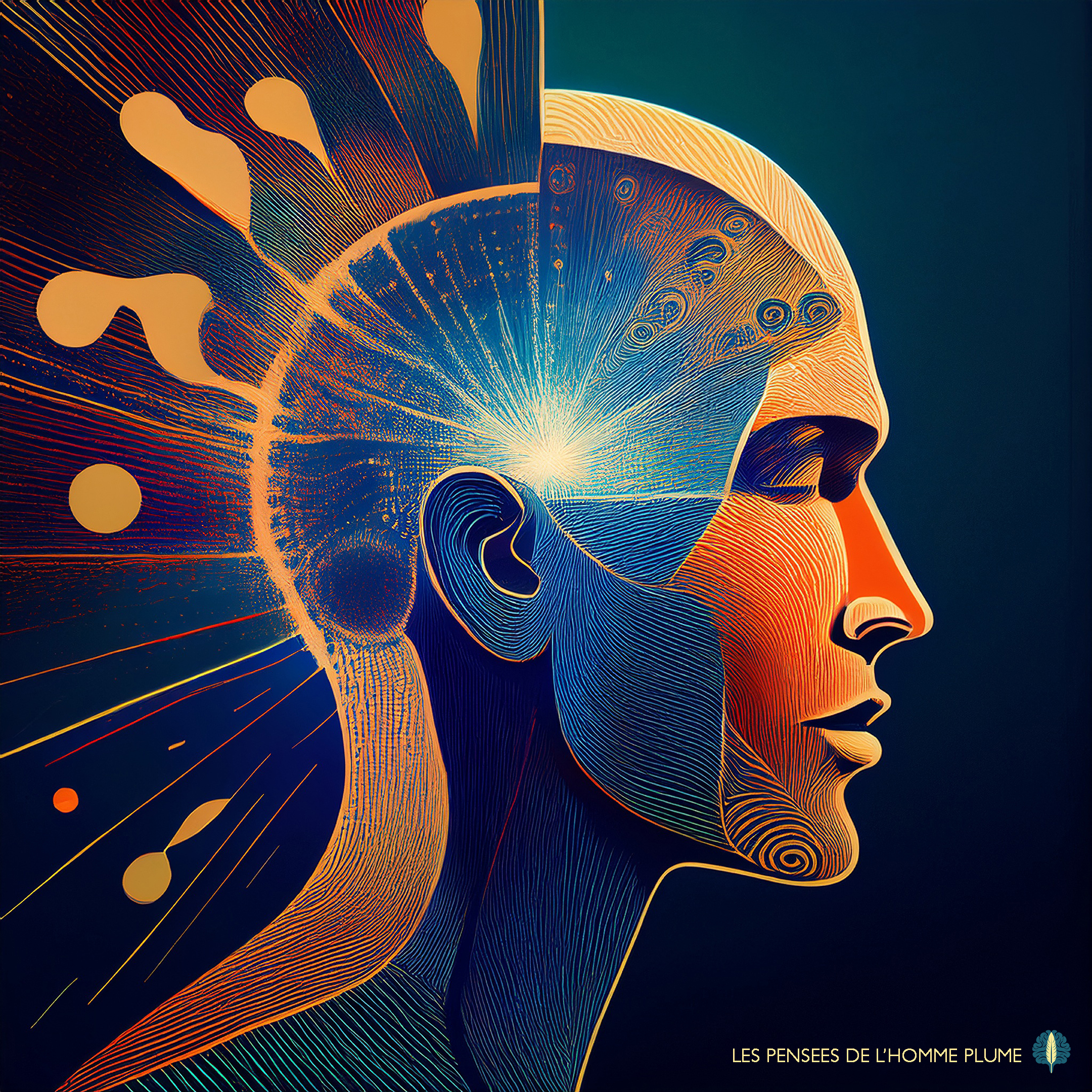
QUAND LE SYSTÈME NERVEUX DISJONCTE
UNE PLONGÉE AU CŒUR DU MELTDOWN AUTISTIQUE
INTRODUCTION
Récemment, j’ai vécu un meltdown autistique. Le premier depuis quatre ans et le premier depuis que je sais que j’ai un TSA.
Quatre années de régulation, de travail intérieur, de soin, de compréhension. Quatre années sans effondrement brutal, sans que mon corps et mon système nerveux n’explosent sous la charge. En général, lorsque cela menace, j’ai appris à me retirer, à créer une forme de sas, un espace intérieur ou physique dans lequel je peux désamorcer le trop-plein. Mais cette fois, comme il y a quatre ans — la dernière fois où cela m’était arrivé —, le confinement n’a pas fonctionné. Une phrase anodine a involontairement traversé la membrane de protection et est venue percer directement dans certains de mes blessures les plus profondes.
Le meltdown, dans sa définition clinique, est une réaction neurologique extrême provoquée par une accumulation de stress, de surcharge sensorielle, émotionnelle ou cognitive. Il s’agit d’un effondrement du système nerveux central — un moment où la personne autiste perd littéralement la capacité de contenir ce qu’elle subit.
Ce n’est ni une crise de colère, ni une tentative de manipulation. C’est un court-circuit. Une perte de contrôle que le corps vit comme une urgence vitale. Cette réaction n’a rien de théâtral ni d’instrumentalisé. Elle exprime un trop-plein, un seuil dépassé, un système de régulation arrivé à saturation.
Pour ma part, mes crises prennent plus souvent la forme de shutdowns. Plus aucun mot, plus aucun geste. Mon « disque dur interne » se fige et mon corps entre en veille.
Dans ces moments-là, je ne peux que dormir, comme si le sommeil était la seule stratégie autorégulatrice encore accessible. Mais un meltdown, c’est autre chose. C’est l’explosion, et chez moi, elle n’arrive jamais sans un retour violent du passé.
I. TRAUMA ET CRISE
Quand le passé ravive l’effondrement
Mon meltdown récent n’a pas été provoqué par une lumière trop vive ou un environnement surstimulant. Il a été causé par une simple phrase, anodine en apparence, formulée de manière maladroite et sans aucune intention de me blesser, mais qui a déclenché un effondrement nerveux total. Parce que cette phrase, émise par une personne de confiance, venait involontairement taper à nu dans un noyau de mon histoire, elle a réveillé un trauma originel que je croyais avoir dépassé.
Sans entrer dans les détails — j’ai déjà écrit sur ce sujet —, j’ai eu un père violent.
L’un de ses « jeux », pendant mon enfance, était de s’asseoir, dans ses moments de « déprime », sur le canapé du salon avec un revolver chargé. Ma mère avait ainsi confisqué la boîte de cartouches, qu’elle avait longtemps gardée cachée dans sa voiture, sous le siège conducteur.
J’ai grandi avec la peur réelle qu’un massacre familial puisse avoir lieu un jour, sur un coup de tête. L’enfant que j’étais vivait en état d’alerte permanent. Cet état d’hypervigilance a accentué mes particularités autistiques, que je ne soupçonnais pas alors, et a nourri un harcèlement scolaire quotidien. Il n’était donc pas rare, dans l’enfance, que j’explose de rage et cogne mes agresseurs avec encore plus de violence qu’eux, ce qui a souvent eu pour conséquence de les tenir à distance.
L’institutions n’a, par ailleurs, jamais fait grand-chose pour contenir les agressions que je subissais quotidiennement. Peut-être est-ce l’une des raisons pour lesquelles mes accès de colère ont toujours été ignorés par mes enseignants en primaire et au cycle d’orientation. Le problème se « réglait », plus ou moins, sans leur intervention.
Aujourd’hui encore, lorsque certaines situations réactivent ces circuits de détresse archaïque, mon système nerveux répond comme il a appris à le faire : par une tentative désespérée de reprise de contrôle par le corps. Dans ces rares moments, je me frappe, sans intention de me blesser gravement.
Ce n’est pas de l’automutilation au sens psychiatrique. C’est une manière de circonscrire la douleur dans une zone physique identifiable, de la projeter sur un point précis pour qu’elle ne m’envahisse pas tout entier.
Une stratégie archaïque, mais profondément logique dans le langage du système nerveux.
II. CRISES AVEC COMPORTEMENTS AUTO-AGRESSIFS
Une tentative de régulation
De nombreuses personnes autistes vivent un meltdown. Ce n’est ni pathologique, ni volontaire, ni signe d’un trouble psychiatrique isolé. Ce sont des stratégies de survie face à une réalité devenue temporairement insoutenable.
Dans ces moments, la douleur physique localisée permet de canaliser l’attention et d’éviter l’implosion mentale. Le corps devient une ancre, une tentative de retrouver un repère au sein du chaos.
Ces comportements peuvent être qualifiés de comportements auto-agressifs.
Ils se distinguent des comportements hétéro-agressifs, plus rarement présents mais parfois confondus à tort dans le discours public ou professionnel.
Les premiers sont dirigés contre soi : se frapper, se griffer, se cogner, voire se scarifier. Chez certaines personnes, ils peuvent s’accompagner de flots d’injures sans destination précise. Il arrive également, dans ces moments, que des autistes s’enfoncent dans la peau des objets du quotidien — crayons, fourchettes, ciseaux, bouchons, épingles — comme une manière extrême de tenter de gérer une surcharge émotionnelle ou sensorielle.
Les seconds visent l’extérieur : jeter un objet, crier contre une personne, pousser ou frapper.
Dans tous les cas, ces crises doivent être comprises comme des réponses extrêmes à une situation extrême, et non comme une volonté consciente de nuire.
Les enfants autistes ayant grandi dans des environnements violents développent plus souvent ces réflexes de survie. Ces gestes ne sont pas appris dans une intention rationnelle, mais intégrés très tôt comme modes de régulation face à la terreur ou l’impuissance. Le conditionnement traumatique modifie les circuits de réponse au stress, ce qui rend encore plus complexe la gestion de ces épisodes à l’âge adulte.
Pour ma part, si ces crises étaient récurrentes dans l’enfance et l’adolescence, elles sont devenues, heureusement, extrêmement rares à l’âge adulte.
III. MELTDOWN ET STÉRÉOTYPES
Déconstruire les idées reçues
Un meltdown n’est jamais une crise de caprice, une colère instrumentalisée, une violence gratuite ou une demande d’attention. Ce n’est pas un spectacle. C’est une perte de contrôle neurologique totale.
Une fois la crise passée, l’effondrement peut être profond. La personne se vide, devient absente, parfois mutique pendant des heures. Cet état de post-crise, que l’on pourrait appeler un shutdown secondaire, est souvent incompris par l’entourage. Il ne s’agit pas d’un retour au calme, mais d’une forme d’épuisement extrême, où le corps et le système nerveux coupent temporairement l’accès à la parole, aux émotions ou à l’environnement, pour tenter de se réparer.
Dans la culture dominante, la crise est encore trop souvent vue à travers une grille d’interprétation morale : il y aurait ceux qui « se contrôlent » et ceux qui « cèdent ». Or, dans le cas du TSA, il ne s’agit pas de cession, mais de saturation. De la même manière qu’un système électrique saute lorsque la tension dépasse ses capacités, un cerveau autistique s’effondre lorsqu’il ne peut plus rien traiter.
IV. AUTISME ET VIOLENCES FAMILIALES
Une vulnérabilité accrue
On sait aujourd’hui que les personnes autistes issues de familles dysfonctionnelles paient une double peine : celle d’avoir un système nerveux encore plus sensible, plus perméable, plus réactif, et celle de devoir composer avec une insécurité émotionnelle structurelle. L’absence de repères fiables, de figures stables et contenantes, engendre des mécanismes de survie qui se réactivent en boucle à l’âge adulte, souvent à leur insu.
Les femmes autistes paient quant à elles une triple peine. En plus de ces deux dimensions, elles vivent dans une société patriarcale où elles apprennent très tôt à masquer, à se conformer, à se taire. Le patriarcat façonne les comportements sociaux en niant les émotions fortes, en valorisant l’effacement.
Leurs crises, bien que moins visibles, n’en sont pas moins intenses. Elles se traduisent souvent par de l’angoisse, des épisodes dissociatifs, des douleurs chroniques ou des formes d’auto-agression discrètes. Ce tableau, de plus en plus reconnu comme l’un des effets du camouflage autistique chez les femmes, met en évidence une violence psychique durable, trop rarement identifiée ou prise au sérieux par l’entourage et les professionnels.
Dans mon cas, je crois que c’est précisément à cause de ces traumatismes d’enfance et d’adolescence que j’ai encore aujourd’hui tant de mal à accueillir les retours positifs, qu’ils viennent de mes élèves, de mes collègues ou de mes proches. J’ai mis en place une stratégie de minimisation presque automatique : je désamorce les compliments par l’humour, je me réfugie derrière l’idée que je ne fais « que mon travail », ou encore je détourne l’attention vers d’autres.
Cette difficulté à intégrer la reconnaissance comme une donnée légitime dans mes relations semble directement liée à une absence d’ancrage affectif stable dans mes premières années.
Avec le recul, je crois que le meltdown que j’ai traversé récemment a été déclenché par une prise de conscience inédite : celle des violences que j’avais traversées et que, jusque-là, j’avais toujours racontées à distance, de manière clinique, presque mécanique.
Cette dissociation, que beaucoup d’interlocuteurs ont interprétée comme de la maîtrise ou de la résilience, était en réalité une stratégie de survie profondément ancrée.
Pour moi, ces violences n’étaient pas identifiées comme telles ; elles étaient la norme, puisque je n’avais pas d’autre référentiel.
Je ne savais pas ce qu’était un environnement familial sain. Grandir dans un climat de tension constante, de non-dits ou de peur rendait cette notion abstraite, presque étrangère. Ce n’est que maintenant, avec la psychothérapie, les mots, le temps et la sécurité émotionnelle, que ces couches de protection commencent à se fissurer.
V. APAISER SANS BRUSQUER
Ce qui aide vraiment
Face à une personne en meltdown, il ne s’agit pas de raisonner ou de « calmer » comme on le ferait avec un enfant capricieux. Ce qui apaise, c’est d’abord l’absence de stimuli supplémentaires.
Créer un environnement calme, sans intrusion. Parler doucement ou se taire. Éloigner les objets potentiellement dangereux sans gestes brusques.
Offrir des stratégies de régulation sensorielle simples : une couverture lestée, un objet à manipuler, une pression profonde sur les épaules, ou parfois simplement la possibilité de se retirer dans une pièce sombre.
Mais surtout : valider. Dire simplement, sans juger : « Tu es en sécurité. Tu as le droit d’aller mal. » C’est souvent cela qui fait basculer la crise vers l’apaisement. Une reconnaissance sincère de ce que vit la personne. Une manière de recréer un cadre contenant, après la déflagration.
VI. ÉCRIRE POUR RÉPARER
Briser le silence
J’écris cet article aujourd’hui pour démystifier, expliquer, mais aussi réparer.
Réparer en moi, peut-être réparer ailleurs.
Écrire, c’est cartographier un territoire longtemps resté enfoui. C’est redonner un langage à ce qui semblait inexprimable. Ce n’est pas une catharsis, mais un acte politique : une manière de reprendre place, de nommer, de témoigner.
Refuser le silence, c’est aussi refuser l’effacement et l’oubli.
Je n’ai pas honte de mes rares meltdowns. J’ai honte de la violence, physique, psychique, symbolique et systémique que j’ai dû subir et de tout ce que j’ai dû contenir pendant trop longtemps.
Mais ce silence, aujourd’hui, n’est plus une option.