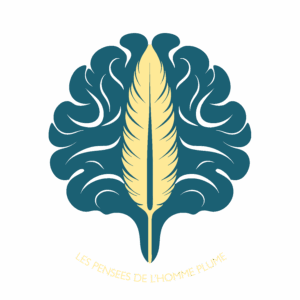DE LA SURADAPTATION À LA SOUVERAINETÉ PARTIELLE
Itinéraire d’un professionnel atypique dans un monde normatif
Introduction
Mon parcours professionnel ne saurait être réduit à une suite de diplômes et de postes occupés. Il constitue plutôt un terrain d’observation privilégié des tensions entre l’individu singulier et les structures normatives qui encadrent le travail.
Vu de l’extérieur, mon parcours semble suivre une trajectoire ordonnée, sans rupture apparente. Cette impression de continuité repose en fait sur des efforts constants de suradaptation, déployés sans que j’en aie pleinement conscience pendant de nombreuses années.
Ce n’est qu’à l’âge de 45 ans que j’ai découvert que je vivais avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA), longtemps masqué, ou plutôt compensé, par un haut potentiel intellectuel (HPI) qui me permettait de m’ajuster, souvent au prix d’un effort invisible.
Ce diagnostic tardif a agi comme une clé de lecture rétrospective, éclairant sous un nouveau jour des années de stratégies d’adaptation, souvent épuisantes, pour répondre à des injonctions dont je ne comprenais pas toujours la pertinence, mais auxquelles je me conformais pour rester dans les limites de ce qui était socialement toléré.
Loin d’être linéaire, mon parcours témoigne d’une quête de sens, souvent en décalage avec les normes implicites des milieux professionnels, un décalage né de ma sidération face à l’incohérence et aux violences symboliques de certains comportements.
Ce texte se propose d’en analyser le parcours, en interrogeant ce qu’il révèle des modes d’inclusion et d’exclusion propres à notre société, et en explorant les tensions entre norme et singularité, performance et épuisement, conformité et invisibilité.
I. Origine et aspirations
Enfant, je nourrissais le désir de devenir vétérinaire. Derrière ce projet se profilait déjà une double orientation : d’une part, un lien viscéral au vivant, aux animaux en particulier ; d’autre part, une volonté de mettre mes compétences au service d’une cause dépassant l’intérêt individuel.
Ce rêve a rapidement buté sur la barrière linguistique : ma difficulté avec l’allemand, indispensable pour suivre un cursus à Berne ou Zurich, a rendu ce chemin impraticable.
Cette première bifurcation à l’adolescence n’est pas anodine : elle marque l’entrée précoce dans un rapport ambivalent aux structures éducatives, puisque ma rigidité autistique et mon absence d’affinité avec cette langue rendaient impossible son apprentissage, malgré l’attrait du projet académique.
II. Les humanités comme refuge et horizon
C’est finalement vers les lettres et l’histoire que je me suis tourné. L’université m’a offert un espace où ma pensée pouvait s’épanouir dans l’analyse, la critique et la transmission du savoir. Une maîtrise d’histoire, suivie d’une maîtrise en littérature française, ont constitué les piliers de ma formation. Cette trajectoire exigeante traduisait à la fois mon goût pour l’herméneutique, ma rigueur intellectuelle et mon désir d’explorer la complexité des récits humains.
Ce choix n’était pourtant pas neutre : les humanités se veulent ouvertes et critiques, mais elles fonctionnent aussi comme un filtre social et culturel, valorisant certaines formes d’excellence, conformes à des codes implicites de prestige, de références culturelles ou de capital social, au détriment d’autres.
Les “autres”, ceux qui s’écartent de ces codes, voient souvent leurs compétences et leur potentiel sous-estimés : une maîtrise du langage académique jugée insuffisante malgré la profondeur et la pertinence de leur pensée, ou des profils atypiques, autodidactes, esprits visuels, sensibilités singulières, dont l’originalité est trop souvent ignorée, mal comprise, voire perçue comme une faiblesse. Cette logique de reconnaissance sélective contribue à renforcer des hiérarchies symboliques qui ne disent pas leur nom, tout en reléguant dans l’ombre des formes de savoir et d’intelligence pourtant essentielles.
Dans ce contexte, j’y ai trouvé un terrain d’expression, mais aussi l’expérience du décalage, de l’effort constant pour me couler dans des moules implicites.
III. L’enseignement comme immersion dans la norme
Devenir enseignant m’est apparu comme l’extension naturelle de cette formation. Transmettre, éveiller, confronter les élèves à la richesse du langage et à la pensée critique : autant de missions qui résonnaient avec mes valeurs, tout en s’accordant à certains de mes intérêts spécifiques.
Pourtant, l’entrée dans l’institution scolaire s’est révélée une immersion brutale dans un univers fortement codifié.
Je pensais naïvement y rencontrer des universitaires curieux du monde et de l’autre, ouverts aux débats d’idées, mais j’ai rapidement constaté que la réalité était plus complexe.
L’école ne transmet pas seulement des savoirs ; elle impose des codes relationnels, des rythmes, des hiérarchies. L’enseignant y est sommé de jouer un rôle qui dépasse largement la pédagogie. J’ai dû composer avec cette exigence, oscillant entre ma vocation première – instruire dans le respect et la bienveillance – et les contraintes systémiques d’une institution soucieuse d’ordre et de conformité. Cette tension m’a conduit à développer des stratégies personnelles pour naviguer dans ce cadre tout en préservant ma vocation : garder une distance naturelle avec mes élèves, mes collègues et ma hiérarchie, utiliser l’humour comme outil de régulation, et intervenir avec clarté face à l’incongruence.
IV. La constellation des pratiques parallèles
En marge de l’enseignement, je me suis formé à des pratiques énergétiques et spirituelles : sophrologie, reiki, soins énergétiques, massage, tarologie. Ces démarches, loin d’être accessoires, constituent un contrepoint essentiel à l’institution scolaire. Elles ouvrent un espace de respiration, où le corps, l’intuition et la sensorialité retrouvent leur place face à la rigidité des cadres scolaires.
Elles traduisent aussi une cohérence interne : je n’ai jamais conçu le travail comme une simple activité rémunératrice, mais comme une manière d’incarner mes valeurs, de relier la connaissance à l’expérience vécue. Ces pratiques ne s’opposent pas à mon rôle d’enseignant, elles le complètent, en offrant une profondeur relationnelle et une ouverture à la diversité des manières d’être au monde.
Parallèlement, mes activités de musicien, réalisateur et modèle photo m’ont offert des espaces d’expression complémentaires, où créativité et sensorialité, largement nourries par ma synesthésie, prenaient le pas sur les contraintes normatives. Ces expériences m’ont permis d’explorer pleinement ma cosmogonie intérieure et d’affiner mon regard sur le monde, ainsi que sur les interactions humaines. Elles ont constitué un contrepoint vivant à la rigueur intellectuelle, renforçant la cohérence entre ma pensée et ma quête d’individuation.
V. Les tensions et leurs coûts
Naviguer entre ces univers – institution normative d’un côté, pratiques alternatives et travail artistique de l’autre – n’a pas été sans coûts. L’adaptation constante, la gestion des attentes implicites, la confrontation aux incompréhensions ont souvent conduit à l’épuisement, parfois à l’écroulement autistique.
Ces moments de crise ne sont pas seulement des expériences individuelles : ils révèlent combien notre société peine à intégrer des fonctionnements divergents. Ils mettent en lumière les tensions que rencontre toute personne cherchant à concilier exigence intellectuelle, intégrité personnelle et appartenance à des structures collectives, tout en soulignant l’importance d’inventer des manières de fonctionner qui respectent sa singularité.
VI. L’éveil d’une souveraineté partielle
Progressivement, un mouvement s’est amorcé : passer de la simple adaptation à une forme de souveraineté. La reconnaissance de mon fonctionnement autistique et la lucidité acquise sur certaines dynamiques relationnelles et institutionnelles m’ont permis de réévaluer mes choix.
Cette évolution s’accompagne d’un intérêt renouvelé pour la recherche, la compréhension et la communication autour du TSA, et plus largement, de la neurodiversité. Mon parcours, traversé d’expériences contrastées, constitue un terrain de réflexion privilégié pour observer les dysfonctionnements systémiques et imaginer des pistes de transformation, car, à mes yeux, le TSA met justement en lumière l’inadéquation des normes sociales dominantes, ainsi que les violences symboliques invisibilisées qui traversent notre société.
Conclusion
Mon itinéraire n’a pas valeur de modèle à reproduire. Il illustre plutôt, à travers mes bifurcations, mes résistances et mes réinventions, les tensions fréquentes entre aspirations personnelles et contraintes institutionnelles. Ce que j’ai traversé relève autant d’expériences individuelles que de situations partagées par d’autres confrontés à des cadres normatifs.
C’est aussi une fenêtre sur la manière dont nos sociétés accueillent — ou peinent à accueillir — la différence.
Mon parcours professionnel apparaît moins comme un aboutissement que comme un point de départ. Il m’encourage à poursuivre la réflexion, à partager mes observations et à explorer une autre manière d’être au travail : non pas comme simple lieu d’adaptation forcée aux normes, mais comme espace de construction commune, où l’atypisme, un jugement fondé sur un point de vue normatif, peut être une ressource et non un obstacle.