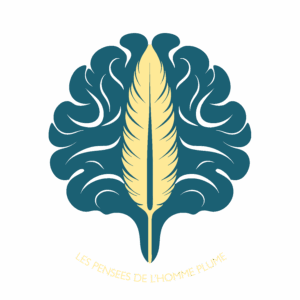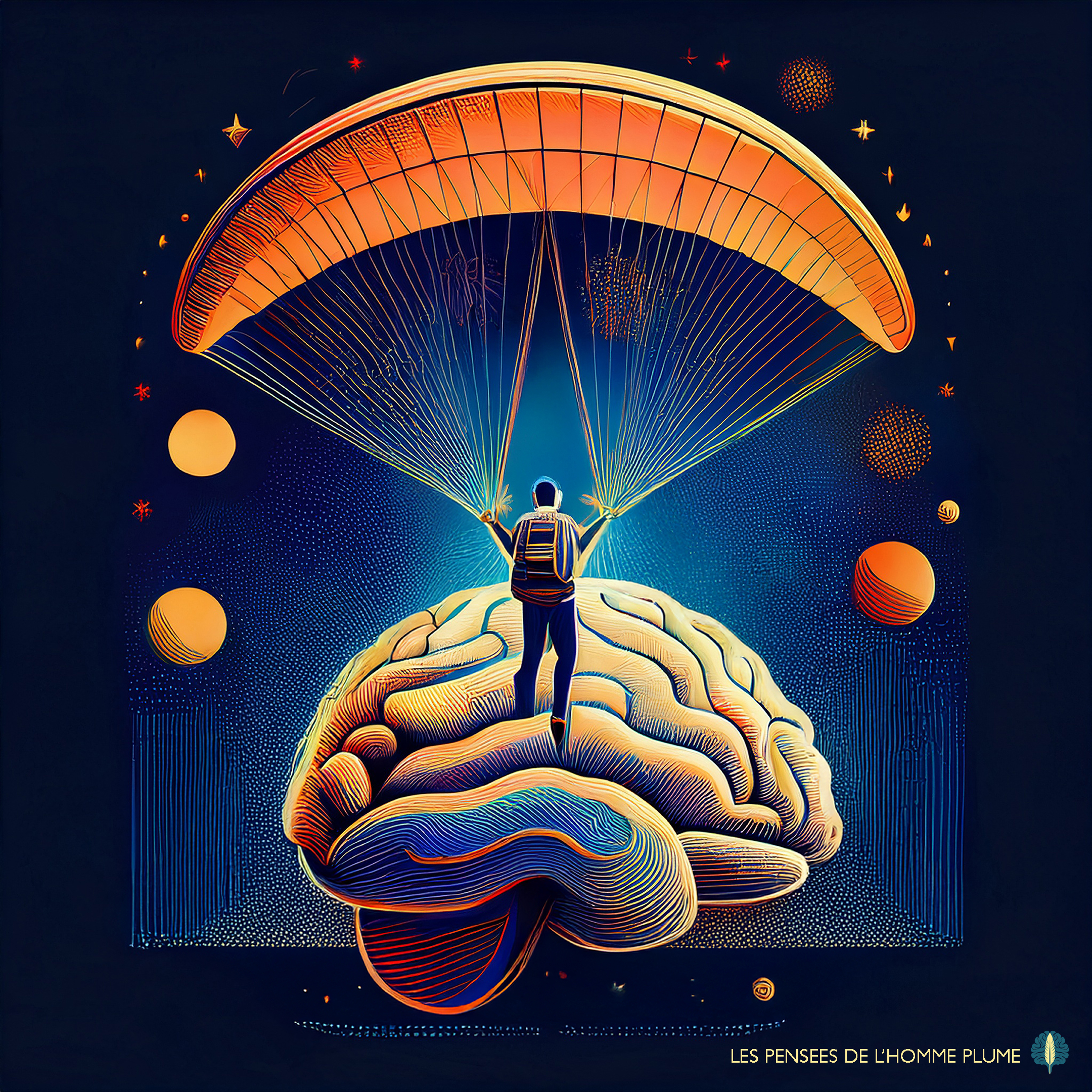EXPÉRIENCE INTÉRIEURE ET POSTURE EXISTENTIELLE
Écrits introspectifs sur le rapport à soi, à la solitude, à l’hypersignifiance, à la contemplation et à la présence au monde.
Cette section rassemble des écrits où l’introspection, la contemplation et l’attention aux nuances de l’expérience vécue tiennent une place centrale.Le rapport à soi, à la solitude, à la densité de sens et à la présence au monde est abordé comme une dimension essentielle de l’existence, offrant un contrepoint intime aux réflexions plus analytiques.
Cliquez sur l’image pour accéder à l’article
Un acte de vérité dans une société validiste
Résumé de l’article
Accepter d’être soi dans une société normée, c’est choisir la vérité plutôt que la conformité.
Pour les personnes autistes, ce chemin passe souvent par un écroulement, une remise en question radicale du masque social imposé dès l’enfance.
Retirer ce masque coûte cher, mais c’est le prix d’une liberté intérieure réelle, celle de ne plus se trahir.
Dans une société validiste, être soi n’est pas seulement un acte personnel : c’est un positionnement politique.
Refuser les normes capacitistes, créer des espaces sûrs, affirmer une culture autistique, c’est résister à une hiérarchie implicite des fonctionnements humains.
Être pleinement soi, sans excuses, c’est déjà élargir le monde.
Une esthétique de la présence
Résumé de l’article
Chez certaines personnes autistes, l’émerveillement ne se manifeste pas de façon ponctuelle ou circonstancielle, mais comme un état perceptif quasi permanent.
Il ne s’agit pas d’un enchantement naïf, mais d’un rapport au monde profondément sensoriel, précis et souvent ineffable.
Tout devient susceptible de générer de l’émerveillement : la façon dont la lumière rebondit sur une surface, les modulations infimes d’une voix, le mouvement d’un animal, la texture d’un silence.
Cette hypersensibilité sensorielle, souvent présentée comme une entrave, ouvre en réalité sur un registre de perception d’une densité particulière.
Là où le monde dit « neurotypique » filtre, trie et hiérarchise, l’esprit autistique capte, enregistre, s’émerveille.
Rien n’est trop petit, trop insignifiant ou trop banal : tout mérite attention.
L’émerveillement devient alors une forme de résistance à l’indifférence, une manière d’habiter le monde avec intensité.
Vers une écologie des rythmes autistiques
Résumé de l’article
Et si notre rapport au temps n’était pas universel, mais profondément normé ?
Pour les personnes TSA-SDI ou HPI, le temps dominant – linéaire, rapide, optimisé – devient souvent un carcan.
Leur rapport au temps est autre : sensoriel, incarné, dense.
Il ne s’agit pas d’un déficit, mais d’un rythme minoritaire, vital, souvent incompris.
Ce texte invite à reconnaître la richesse des temporalités atypiques : entre immersion, hyperfocus, lenteur ou anticipation, ces rythmes révèlent une écologie du temps plus vivante et plus juste.
Résister aux cadences imposées devient alors un acte d’insoumission sensible, et une voie vers une société réellement inclusive.
Une démarche de structuration et de partage
Résumé de l’article
Ce texte retrace le point de bascule : celui d’un arrêt de travail prolongé, vécu comme une coupure brutale du lien pédagogique.
En réponse à cette rupture, une transition s’est amorcée — d’un cadre institutionnel vers un espace d’écriture plus libre, nourri par l’analyse du TSA et une volonté de transmission repensée.
Un message reçu sur ma boîte mail professionnelle a agi comme déclencheur, révélant la puissance des gestes discrets dans la continuité des liens.
Ce compte n’a pas vocation à enseigner, mais à articuler. Articuler des expériences, des concepts, des observations systémiques.
Penser le TSA sans réduction ni simplification.
Créer des passerelles entre vécu et théorie, entre perception fine et mise en forme.
Une tentative de faire langage autour de ce qui souvent échappe aux mots.
Ce refuge bienveillant
Résumé de l’article
La solitude et l’isolement sont souvent confondus, mais alors que l’isolement est une contrainte, la solitude est un choix, un espace sacré de reconnexion avec soi-même.
Elle nous permet d’explorer nos pensées, de nourrir notre créativité et de cultiver une autonomie émotionnelle.
Pour les personnes neuroatypiques, elle est un refuge essentiel face au tumulte du monde.
En embrassant la solitude, nous nous offrons un souffle de vie, une parenthèse de paix et de clarté.
Entre liberté et responsabilité
Résumé de l’article
L’amour inconditionnel est souvent idéalisé. Pourtant, dans la réalité, il peut nourrir des déséquilibres profonds, où l’un s’efface pendant que l’autre s’autorise tout.
Refuser l’inconditionnalité, ce n’est pas aimer moins. C’est aimer mieux. C’est reconnaître que toute relation saine repose sur des conditions fondamentales : respect, réciprocité, sécurité.
Dire non, poser un cadre, mettre fin à un lien destructeur : autant d’actes d’amour envers soi… et envers l’autre.