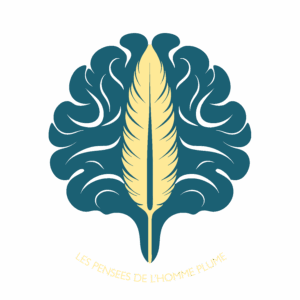INTIMITÉ ET SENSORIALITÉ
ENTRE HYPERSENSIBILITÉ ET INCOMPRÉHENSION
INTRODUCTION
À la suite de mes précédentes publications, plusieurs personnes diagnostiquées TSA ou proches d’autistes m’ont sollicité pour approfondir certains sujets, notamment la question de l’intimité et des relations.
Ce texte s’adresse principalement aux personnes autistes sans déficience intellectuelle, car il reflète ce que j’ai observé à travers mes lectures et mes discussions avec des interlocuteurs au profil similaire au mien.
Mon approche, avant tout empirique, est basée sur des échanges réels et consentis, et vise à offrir des éclairages sur la manière dont les autistes sans déficience intellectuelle vivent leur quotidien, en particulier dans les domaines souvent mal compris comme l’intimité et les relations amoureuses.
Le cas concret que je vais évoquer ici a été partagé avec l’accord des personnes concernées, dans le but de mieux comprendre et expliquer les nuances de la vie émotionnelle des autistes sans déficience intellectuelle (bien que ce terme soit générique et, je ne le dirai jamais assez, ne peut rendre compte de toute la diversité des profils que l’on peut croiser).
Mon objectif est double : offrir aux personnes neurotypiques une perspective plus claire sur les défis que rencontrent les autistes, tout en fournissant aux neuroatypiques des pistes de réflexion sur leurs propres expériences.
À travers cette démarche, j’aspire à créer des ponts de compréhension mutuelle, afin que chacun puisse mieux vivre sa différence et enrichir ses relations.
I. DÉFIS DE L’INTIMITÉ CHEZ LES AUTISTES
Très tôt dans leur vie, les personnes autistes se heurtent à un décalage profond dans leurs relations avec les autres. Ce décalage ne réside pas seulement dans la communication verbale, mais s’étend souvent à toute la sphère émotionnelle et sensorielle.
Pour beaucoup, les interactions intimes, qu’elles soient amicales ou amoureuses, sont empreintes d’un certain malaise, dû à une hypersensibilité exacerbée ou à une difficulté à décoder les signaux sociaux implicites qui régissent les relations.
Il est important de comprendre que les hommes et les femmes autistes vivent ces difficultés de manière légèrement différente, notamment en raison des attentes genrées que la société projette sur eux.
a. Les femmes autistes
Les femmes autistes, souvent sous-diagnostiquées ou diagnostiquées tardivement, sont confrontées à une double injonction : d’une part, elles doivent se conformer aux attentes classiques de féminité (douceur, expressivité émotionnelle, intuition relationnelle) et, d’autre part, elles doivent masquer leurs traits autistiques.
Cela peut engendrer un malaise profond. Elles sont parfois perçues comme « trop distantes » ou « trop sensibles », notamment dans le cadre de liaisons amoureuses où l’on espère d’elles une connexion fluide, spontanée et implicite.
Ce qui, dans les faits, s’avère difficile pour elles.
b. Les hommes autistes
Beaucoup d’hommes autistes, quant à eux, sont fréquemment perçus comme étant distants ou manquant de « virilité », car la société attend d’eux qu’ils prennent des initiatives en matière de séduction et de sexualité.
Or, la lecture des signaux non verbaux, si essentielle dans ce domaine, est précisément ce qui leur fait défaut.
Par conséquent, ils sont régulièrement confrontés à des incompréhensions et des malentendus dans leurs interactions. Leur hypersensibilité émotionnelle, souvent invisible, est mal interprétée, voire rejetée, ce qui contribue à creuser davantage le fossé entre leur vécu interne et l’image qu’ils projettent.
c. Les personnes autistes non-binaires et la question du genre
Il est essentiel de prendre en compte la situation des personnes autistes non-binaires, qui font face à des défis spécifiques, tant en raison de leur neuroatypie que de leur identité de genre.
Ne se reconnaissant ni comme homme ni comme femme, ces personnes doivent naviguer dans une société où les codes genrés dominent les relations intimes et sexuelles. Pour elles, l’enjeu est double : déconstruire les attentes implicites liées à la binarité du genre, et faire face à une incompréhension plus marquée de leur hypersensibilité et de leur approche de l’intimité.
Leur expérience est souvent celle d’un malentendu récurrent, non seulement en matière de lecture des signaux sociaux, mais aussi dans la manière dont elles veulent affirmer leur propre identité au sein de relations intimes.
La communication explicite et l’accompagnement dans l’expression des besoins, qu’ils soient émotionnels ou physiques, deviennent donc essentiels pour éviter les frustrations ou les quiproquos.
II. LES ATTENTES SOCIÉTALES ET LES MALENTENDUS
La société pose des attentes très spécifiques en matière d’intimité et de sexualité, attentes qui sont profondément influencées par des scripts de genre. Les femmes sont supposées être réceptives et affectueuses, tandis que les hommes sont censés être actifs et déterminés. Ces normes imposent aux personnes autistes des rôles auxquels elles peinent à se conformer, générant de l’inconfort et des malentendus.
Les liens intimes se fondent sur des échanges implicites, des signes subtils de consentement et d’intérêt. Or, pour les autistes, ces signes sont souvent indéchiffrables. Cela peut engendrer des situations de confusion, voire d’incompréhension, notamment lorsqu’il s’agit de la sexualité.
Alors même que la société valorise les relations basées sur une communication émotionnelle non verbale, les personnes autistes ont besoin d’un dialogue explicite, rationnel, pour saisir les attentes de leur partenaire.
L’hypersensibilité, un autre trait commun aux autistes, peut compliquer davantage ces relations. Dans l’intimité, chaque geste, chaque contact, peut être vécu de manière amplifiée, créant une ambivalence entre le désir de proximité et la nécessité de se protéger d’une surcharge sensorielle.
III. ÉTUDE DE CAS
Une relation entre neurotypique et autiste
Pour illustrer la complexité de ces interactions, je voudrais partager une histoire — avec l’accord des personnes concernées, qui sont restées en bons termes — celle d’une femme neurotypique ayant vécu une relation avec un homme autiste qui n’avait pas conscience alors de son TSA. Si je choisis de relater cette expérience, c’est parce qu’elle me semble particulièrement éclairante.
Sans vouloir schématiser ni généraliser les relations complexes qui peuvent se tisser entre êtres humains, ni essentialiser quiconque, cette situation permet de mettre en lumière certains malentendus et attentes déçues qui peuvent émerger dans ce type de relation — comme dans toute relation, certes, mais ici, les enjeux spécifiques y ajoutent une complexité singulière.
Les premiers instants de complicité entre cette femme et cet homme étaient profonds, marqués par une connexion émotionnelle très forte. Ce qui est frappant ici, c’est que cette intensité n’a pas été traduite en actes charnels. Pour lui, la simple présence, le soutien du regard et le fait de tisser un moment de proximité étaient déjà ressentis comme une forme d’intimité extrême. La rencontre sexuelle n’a pas eu lieu, mais la perception d’une densité sensorielle était palpable.
Lors de leur second rendez-vous, il y a eu un échange physique plus direct. Le toucher, en particulier, était central. L’homme autiste, hypersensible au contact, vivait chaque caresse avec une profondeur sensuelle forte. Pour lui, chaque geste était presque surchargé d’émotions et de sensations.
Pourtant, malgré cette intensité, la femme neurotypique a commencé à ressentir un malaise. Non pas en raison d’une incompatibilité corporelle, mais parce qu’elle ne trouvait pas l’harmonie affective qu’elle souhaitait.
Ce qui l’a finalement poussée à mettre un terme à l’aspect romantique de leur relation, c’est ce décalage constant entre leurs attentes respectives. D’un côté, elle espérait une forme de partage émotionnel plus fluide, plus spontanée, tandis que, pour lui, bien que profondément connecté à travers le toucher, il restait difficile de verbaliser ou de comprendre les demandes implicites.
Quelque temps après, ils ont réussi à reconstruire leur lien sous une forme amicale.
CONCLUSION
Cette histoire met en lumière la complexité des liens entre autistes et neurotypiques. Les attentes non verbalisées, souvent inconscientes dans les relations intimes, peuvent devenir une source de malentendus et de frustrations pour les deux parties.
Les personnes autistes vivent leur sexualité avec une intensité qui peut être mal comprise, en raison de leur difficulté à décoder les signaux sociaux implicites et de leur hypersensibilité. Il devient donc essentiel, dans toute rencontre, de privilégier une communication explicite et de cultiver une patience et un respect mutuel.
Mon ambition, à travers mes textes, est d’aider les neurotypiques et les autistes à mieux appréhender les spécificités et les besoins de chacun. En construisant des ponts de compréhension et d’empathie, nous pouvons non seulement réduire les malentendus, mais aussi permettre à chacun de bien vivre sa différence et d’enrichir ses relations.