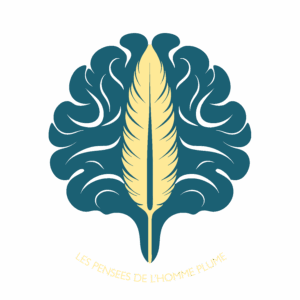LA VIOLENCE SYMBOLIQUE EN MILIEU PRÉTENDUMENT SÉCURISÉ
ILLUSION DE PROTECTION ET MÉCANISMES DE REPRODUCTION
INTRODUCTION
L’illusion d’un dedans pur
Il est tentant de croire que les communautés issues de la marge, qu’elles soient militantes, neurodivergentes ou fondées sur une volonté partagée de soin et d’écoute, se construisent spontanément à l’abri des violences qu’elles dénoncent. Parce qu’elles rassemblent des personnes souvent blessées par les normes dominantes, parce qu’elles se constituent en réponse à l’exclusion ou à l’incompréhension, elles paraissent, de l’extérieur comme de l’intérieur, naturellement plus justes, plus attentives, plus humaines.
Et pourtant.
C’est précisément dans ces espaces se voulant « safe » – sûrs, bienveillants, réparateurs – que peuvent se rejouer, de façon d’autant plus insidieuse qu’elle se prétend désactivée, les mêmes mécanismes d’invisibilisation, de rejet ou de violence symbolique qui caractérisent les structures plus normées de la société majoritaire.
Car, quoi qu’on en dise. Nul groupe, aussi minorisé ou engagé soit-il, n’échappe au poids de l’inconscient collectif. Personne n’échappe à l’intériorisation des logiques de contrôle, à l’évitement des conflits, ni à la reproduction, sous d’autres formes que le pouvoir direct, des hiérarchies sociales.
La question n’est évidemment pas de disqualifier ces communautés ni de nier leur puissance réparatrice, qui constitue pour beaucoup d’entre nous un havre précieux.
Mais d’interroger ce qui s’y rejoue malgré elles – ou peut-être à cause d’elles – quand le souci de sécurité glisse vers une forme de conformisme implicite, quand la bienveillance devient conditionnelle, quand la différence individuelle est vécue comme une menace pour l’homogénéité affective du groupe.
Ce texte est né d’une observation récurrente : celle de voir, au sein d’espaces se voulant « dénormés » et inclusifs, émerger des formes de violence douce – exclusion sans mots, soupçon silencieux, régulation implicite des comportements – qui frappent d’autant plus durement qu’elles se produisent là où l’on croyait pouvoir enfin relâcher la garde. Il ne s’agit pas ici d’un récit personnel, mais d’une tentative d’analyse : comprendre pourquoi et comment des groupes issus de la marge en viennent parfois à reproduire, entre leurs murs, les logiques d’effacement, de suspicion ou d’assignation qu’ils combattent ailleurs.
Il me semble qu’il s’agit d’un appel à la vigilance, non pas contre un ennemi extérieur, mais contre nos propres angles morts.
I. VIOLENCES SYMBOLIQUES
Naturalisation et légitimation
Le concept de violence symbolique, développé par Pierre Bourdieu, désigne une forme de domination douce, subtile et presque imperceptible, qui s’exerce avec le consentement implicite des dominés.
Cette violence ne s’exerce pas par la contrainte directe, mais par l’acceptation tacite d’une norme présentée comme naturelle et légitime, échappant ainsi à toute contestation consciente. Elle ne se manifeste pleinement que lorsque l’on parvient à s’en libérer, ou lorsqu’elle se heurte violemment à notre conscience.
Dans les espaces communautaires minoritaires, cette violence prend une forme particulière : elle ne vient pas d’en haut, mais de l’intérieur. Elle n’est pas verticale, mais latérale. Elle est faite de regards, de silences, de déplacements subtils dans la conversation, d’allusions partagées entre initiés. Il ne s’agit pas d’un rejet explicite : personne ne vous dit « tu n’es pas le bienvenu ». Au contraire, c’est par l’oubli, l’éviction implicite, l’effacement que la violence opère. On contourne votre présence, on parle de vous sans jamais vous nommer. Cette violence symbolique est un art du flou, une danse des contours. Elle ne blesse pas par un coup direct, elle efface par l’absence.
II. QUAND LA COMMUNAUTÉ DEVIENT INJONCTVE
Processus implicite d’éjection et régulation normative
Plus une communauté se pense « différente », plus elle tend à développer, souvent inconsciemment, une norme propre.
Cette norme peut être précieuse – elle permet une cohérence, une base commune. Mais elle peut aussi devenir un outil d’exclusion implicite, surtout lorsqu’elle n’est jamais formulée.
Dans de nombreux groupes se voulant inclusifs, il existe un ensemble de règles tacites : il ne faut pas être trop présent, ni trop absent ; il ne faut pas écrire en privé, sauf si l’autre initie ; il faut partager, mais sans trop se dévoiler ; il faut soutenir, mais pas au point de créer du lien hors du collectif. Ces règles ne sont pas énoncées, ni discutées. Elles circulent comme des évidences. Ceux qui ne les devinent pas sont regardés avec suspicion, puis marginalisés.
On assiste alors à une régulation douce, mais implacable : non pas par des modérateurs ou des sanctions explicites, mais par le retrait de la chaleur, de l’écoute, du lien. Le groupe ne vous expulse pas. Il se referme sur lui-même, et vous laisse dehors.
III. LE SILENCE COMME OUTIL DE RÉGULATION
Un musellement insidieux de l’opposition
Dans ces contextes, le conflit n’a souvent pas droit de cité. Il est perçu comme une menace pour la cohésion du groupe, une atteinte à la sacralité de l’espace. Alors on ne dit pas, on suggère. On ne confronte pas, on parle ailleurs, en évitant soigneusement toute adresse directe.
La parole devient contournée. Ce sont des conversations entre membres, des messages privés qui s’échangent, parfois même des messages collectifs où chacun sait de qui il est question, sans jamais avoir à le nommer. L’effet est redoutable : la personne qui est visée par les sous-entendus ne peut pas répondre, puisque rien n’est explicitement dit. La violence devient alors asymétrique : celui qui se tait contrôle la scène. Celui qui parle, ou tente de rétablir une vérité, est aussitôt soupçonné d’agressivité, voire de manipulation.
IV. L’AUTODÉFENSE CONTRE L’ALTÉRITÉ
Sécurité émotionnelle apparente et exclusion
Plus un groupe cherche la sécurité émotionnelle, plus il peut devenir hostile à l’altérité. L’inattendu, l’intensité, l’ambiguïté deviennent des menaces. Ceux qui ne se fondent pas immédiatement dans les usages affectifs du groupe sont perçus comme dérangeants – non pas parce qu’ils sont violents, mais parce qu’ils déplacent le centre de gravité implicite du collectif.
Cela peut toucher des personnes trop enthousiastes, trop solaires, trop directes, trop incarnées. Ou simplement différentes dans leur manière de créer du lien. Des personnes qui n’ont pas intégré les codes implicites d’un espace, souvent construits autour d’une forme de pudeur affective normée, d’un équilibre émotionnel discret. C’est alors l’hétérogénéité même du vivant qui devient problématique.
Il est nécessaire d’éviter de réactiver entre nous, par le biais de silences complices ou d’exclusions implicites, les blessures que nous affirmons vouloir guérir.
Faire de l’espace communautaire un lieu d’émancipation implique de ne pas sacraliser cet espace en tant que tel. Cela requiert de privilégier constamment le lien vivant à la façade harmonieuse, l’expression authentique à la quiétude feutrée, l’humain aux logiques systémiques.
C’est précisément au sein de cette tension exigeante, mais féconde, qu’une véritable culture du soin peut émerger, et non une simple zone de conformité affective, par nature excluante.
V. VERS UNE ÉCOLOGIE DU CONFLIT
Accueillir la dissension pour renforcer le lien
Il est illusoire de penser qu’un espace véritablement bienveillant puisse se constituer sans accorder une place au conflit. Le refus du désaccord revient à nier la réalité. Il impose une harmonie artificielle qui, tôt ou tard, se fissure. Ce n’est pas le conflit qui fragilise les liens, mais la manière dont on choisit de s’en protéger plutôt que de le traverser.
Une communauté mature est celle qui sait accueillir les désaccords, les malentendus, les tensions, sans recourir à la disqualification immédiate de l’autre. C’est un espace dans lequel il est possible de formuler une incompréhension sans que le lien ne soit pour autant rompu.
C’est aussi un espace où l’on peut affronter l’inconfort avec une solidité intérieure suffisante pour ne pas projeter son propre trouble sur autrui.
CONCLUSION
Vers une vigilance créative
Les communautés issues de la marge possèdent un immense potentiel : relier, réparer, inventer des façons de vivre ensemble différentes. Mais elles ne sont pas à l’abri des dynamiques sociales qu’elles dénoncent : hiérarchies implicites, exclusions silencieuses, conformisme affectif.
Reconnaître ces mécanismes, c’est assumer notre part de responsabilité et rester vigilants face aux logiques que nous pouvons, malgré nous, reproduire. Il ne s’agit pas de viser la perfection, mais de cultiver des espaces où le lien authentique prime sur la façade harmonieuse, où l’expression individuelle est accueillie, et où les tensions ne sont pas refoulées mais traversées avec respect.
C’est dans cette tension exigeante que peut naître une véritable culture du soin : une communauté vivante, capable d’accueillir la différence et le désaccord sans exclure, un espace où le commun se construit dans la conscience de ses propres fragilités et limites.