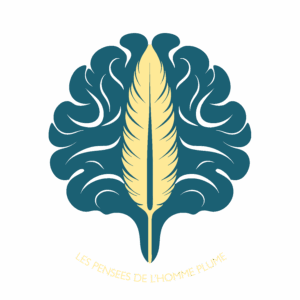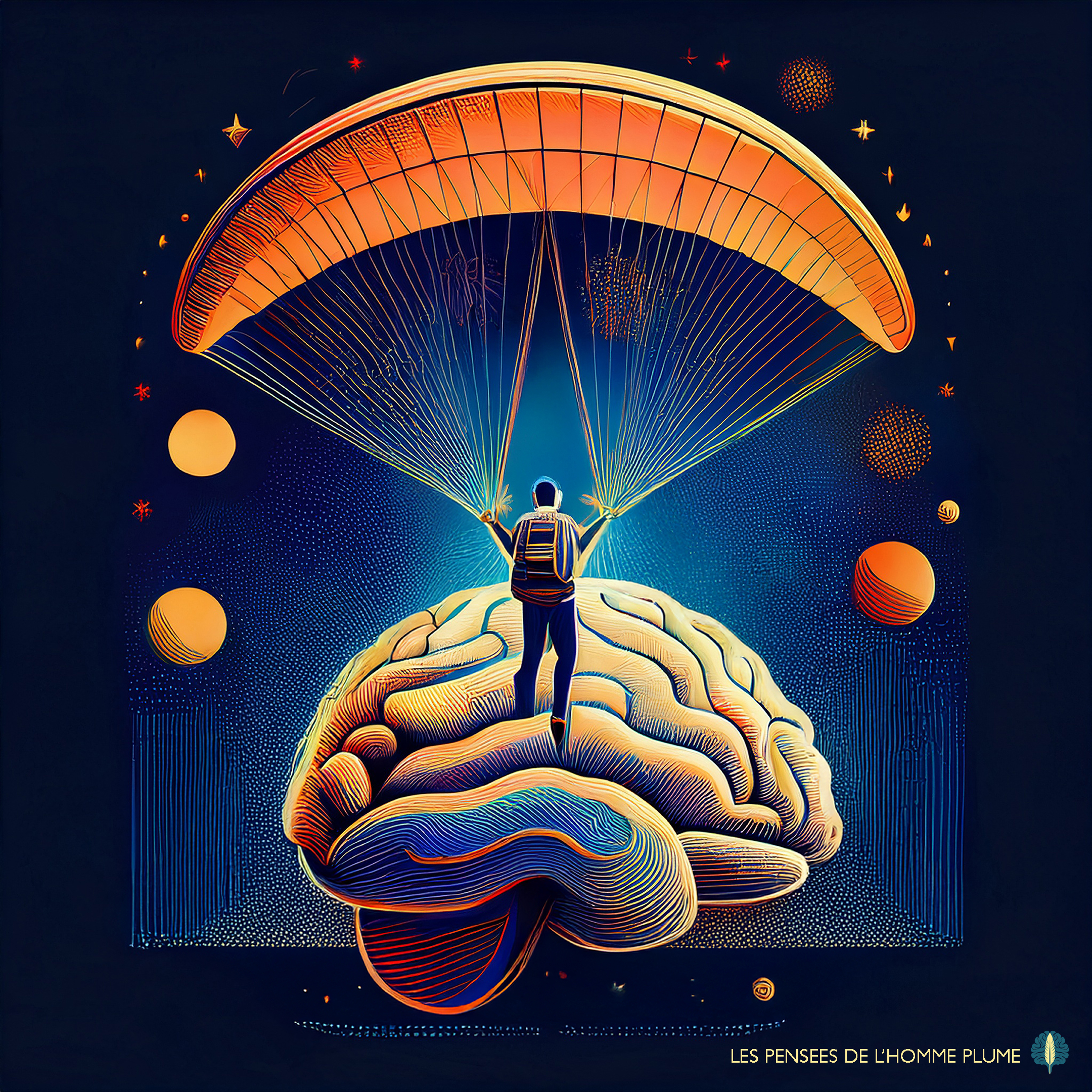
L’ACCEPTATION DE SON SOI PROFOND
UN ACTE DE VÉRITÉ DANS UNE SOCIÉTÉ VALIDISTE
INTRODUCTION
Accepter d’être soi dans un monde qui nous demande d’être autre, c’est choisir la vérité plutôt que la conformité. Bien que ce processus puisse s’avérer douloureux — toute phase d’évolution étant souvent précédée d’une période de profond inconfort — il ouvre de vastes espaces d’expansion et une liberté intérieure, discrète mais puissamment transformatrice, menant à un potentiel accru de souveraineté affective et émotionnelle.
Cette dynamique s’inscrit dans le cadre de la théorie de la désintégration positive développée par Dabrowski (1964), qui postule que le développement psychologique supérieur émerge d’un conflit interne et d’une remise en question des structures psychiques existantes, permettant ainsi une réorganisation et une croissance vers des niveaux supérieurs d’intégration et d’authenticité.
Au cours de mon premier écroulement autistique profond, à une époque où j’ignorais que le TSA pouvait être une clé de compréhension pour mettre des mots sur mon sentiment de décalage avec la norme depuis l’enfance, j’ai compris à quel point mes pensées pouvaient être autant de barreaux d’une prison étroite, bâtie pour me conformer à ce que je croyais être les attentes de mon entourage professionnel et amical.
C’est alors que j’ai compris aussi que la liberté ne consistait pas à tout faire, mais à ne plus me trahir.
I. LE MASKING AUTISTIQUE, UNE ADAPTATION COÛTEUSE
Ce moment de bascule peut survenir tardivement pour les personnes autistes, tant la pression à se conformer est précoce et constante. Être autiste dans une société normopensante et validiste, c’est souvent apprendre, dès l’enfance, à se masquer. À modeler son comportement, sa gestuelle, son intonation, ses intérêts — à cacher ce qui dérange.
Ce camouflage social, décrit dans plusieurs études (Hull et al., 2017), est une stratégie adaptative adoptée par de nombreuses personnes autistes, en particulier les femmes et les personnes assignées femmes à la naissance, pour éviter la stigmatisation.
Mais il a un coût.
Il est aujourd’hui bien documenté que ce « masking » est associé à une fatigue psychique intense, à des troubles anxieux, et à un risque accru de dépression, voire de suicide (Cage & Troxell-Whitman, 2019). L’ « adaptation sociale
», lorsqu’elle implique l’auto-effacement, n’a rien d’une réussite.
II. S’ACCEPTER COMME LEVIER DE MIEUX-ÊTRE
À l’inverse, les recherches menées par l’Office des personnes handicapées du Québec (2022) montrent que l’acceptation de soi agit comme un facteur de protection. Elle favorise l’estime de soi, réduit l’isolement, améliore le bien-être subjectif. C’est une clé intérieure, puissante et discrète. Accepter son fonctionnement, ses rythmes, ses perceptions, ses besoins sensoriels et relationnels — c’est s’autoriser à exister dans son axe.
L’acceptation, et c’est d’autant plus vrai pour certaines personnes autistes chez qui l’alexithymie empêche souvent d’identifier sur l’instant les émotions complexes qui les traversent, est un soulagement qui se déploie dans le corps avant même de pouvoir se traduire en mots. Elle demande parfois une reconstruction a posteriori, pour comprendre ce qui a été vécu, en dehors des schémas normés d’analyse émotionnelle.
III. PEUT-ON ÊTRE SOI DANS UNE SOCIÉTÉ VALIDISTE ?
La question mérite d’être posée sans détour. Accepter son soi profond est une chose ; pouvoir le vivre pleinement dans la société en est une autre. Et c’est là que la notion de validisme entre en jeu.
Le validisme, ou capacitisme, est une forme de discrimination systémique qui établit les personnes valides comme norme implicite du fonctionnement humain.
Il marginalise toutes les autres manières d’être, qu’elles soient motrices, sensorielles, cognitives ou relationnelles (Campbell, 2009). Il agit de manière insidieuse : dans les institutions, les interactions, les dispositifs médicaux, mais aussi dans les représentations culturelles. Comme le racisme ou le sexisme, il s’infiltre dans l’inconscient collectif.
Pour les personnes autistes, cela se traduit par une remise en question constante de leur légitimité à « être comme elles sont ». La société valorise les personnes calmes, souples, productives, émotionnellement lisibles, relationnellement fluides. Ce modèle est à la fois étroit et excluant.
Refuser d’y correspondre, ce n’est pas seulement risquer l’incompréhension : c’est souvent être jugé inadapté, voire pathologisé.
Le blog Hop’Toys, animé par une entreprise engagée dans la conception de jeux éducatifs inclusifs, propose une réflexion approfondie sur les mécanismes du validisme. Il met en lumière la manière dont celui-ci engendre une souffrance souvent invisible et peu reconnue, compromettant le sentiment de légitimité des personnes concernées dans leur manière d’être au monde.
IV. CRÉER DES ESPACES POUR EXISTER PLEINEMENT
Il apparaît dès lors essentiel de promouvoir la création d’espaces où les personnes autistes peuvent exister pleinement, sans avoir à se justifier ni à se conformer aux attentes sociales. Cela implique la mise en place de milieux professionnels véritablement inclusifs, de dispositifs éducatifs adaptés, d’une représentation médiatique respectueuse et informée — mais également la reconnaissance et le soutien de communautés affinitaires.
Ces communautés, qu’elles soient en ligne ou incarnées, permettent aux personnes neurodivergentes de partager leurs expériences, de se sentir reconnues, de tisser du lien sur d’autres bases que la conformité sociale. Les recherches menées par l’Université York (2022) soulignent que le soutien par les pairs et la connaissance de soi sont deux leviers essentiels pour le bien-être des personnes autistes.
Créer ces espaces, c’est refuser de se construire uniquement dans l’altérité normée.
C’est offrir la possibilité d’être soi sans masque, dans un cadre qui reconnaît la diversité des fonctionnements comme une richesse, et non comme un problème à résoudre.
Pour ma part, je serais enclin à penser que s’il existe des cultures masculinistes, féministes, queer, punk, ou encore afro-descendantes, il paraît légitime de créer, centraliser, promouvoir une culture autistique.
Car, comme toute communauté, quoiqu’on en dise, elle possède certains codes communs, permettant d’établir des repères ou des ponts de compréhension mutuelle — même si, comme dans toutes les communautés, les points d’accroche ne garantissent pas une compréhension immédiate ou automatique.
Le spectre autistique étant extrêmement large, le réduire à quelques archétypes serait aussi absurde que de classifier les profils humains en fonction de la couleur de leurs yeux ou de leurs cheveux.
À propos des normes implicites, Lou Lubie, dessinatrice neuroatypique, a récemment publié une excellente bande dessinée intitulée « Racines », qui interroge les injonctions sociétales liées à l’apparence capillaire chez les femmes, notamment racisées — en particulier l’obligation tacite de se conformer à la « taxe rose » afin de préserver une désirabilité sociale, tout en étant payées 24 % de moins que les hommes. Toutefois, ce sujet constitue une autre problématique distincte.
V. L’INTIME EST-IL POLITIQUE ?
Ce qui est intime est souvent politique. Accepter son identité autistique dans un monde validiste, c’est porter une contestation silencieuse mais fondamentale : celle de la hiérarchie implicite des valeurs humaines. En affirmant « je suis ainsi, et je mérite de l’être », on renverse la logique d’adaptation unilatérale à la norme.
Le champ du soin, de l’éducation, de l’emploi — tous sont encore largement marqués par une vision correctrice de la différence.
Le validisme y agit comme un filtre invisible, réduisant l’accès aux ressources, aux droits, à la reconnaissance (OSEO Formation, 2023). Revaloriser les subjectivités atypiques, c’est donc aussi une question de justice sociale.
Accepter son soi profond, pour une personne TSA, n’est pas seulement un chemin de connaissance de soi.
C’est un positionnement. Une posture.
Souvent, un combat.
Chaque fois que nous osons être ce que nous sommes sans nous excuser, nous élargissons le monde.
CONCUSION
De l’affirmation de soi au changement sociétal
La liberté d’être soi n’est pas un luxe, mais une nécessité pour quiconque aspire à vivre avec intégrité. Pour les personnes autistes, cette liberté passe par l’acceptation du soi profond, au-delà des injonctions sociales. Mais cette acceptation ne peut pleinement s’épanouir que si la société elle-même fait un pas vers la diversité, en cessant de hiérarchiser les manières d’exister.
Ce texte n’a pas vocation à offrir une solution unique — surtout pas : ce serait dogmatiser une problématique fondamentalement complexe. Il contribue plutôt à ouvrir une voie : celle de la lucidité, de l’affirmation de soi, et de la construction d’un monde où les subjectivités atypiques ne sont plus seulement tolérées à condition de se taire, mais pleinement accueillies dans leur altérité.
RÉFÉRENCES