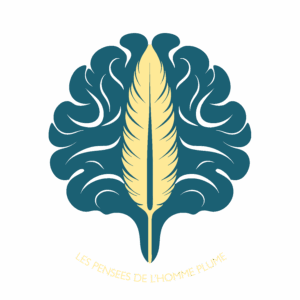LES PRÉJUGÉS SUR L’AUTISME
UN MIROIR DES NORMES ET DES PEURS SOCIALES
INTRODUCTION
Quelques exemples de remarques désobligeante
« Tu ne peux pas être autiste, tu es intelligent, tu souris, tu as de l’humour et de l’empathie, tu as fait des études, tu es en couple et tu es autonome. »
« Tu es autiste ? Tu te tapes la tête contre les murs ? »
« Tu n’es pas autiste, les autistes parlent et bougent comme des robots. »
« Tu n’es pas autiste, les autistes ne comprennent rien. »
Ces remarques, reçues personnellement ou adressées à plusieurs de mes connaissances au profil similaire au mien, illustrent l’étendue des stéréotypes qui persistent autour du trouble du spectre autistique (TSA). Certaines ont été proférées avec bienveillance, d’autres avec un jugement implicite, mais toutes témoignent d’une profonde méconnaissance de la réalité autistique.
L’autisme, loin d’être une maladie, est une condition neurologique qui affecte la perception, la communication, les interactions sociales et les traitements sensoriels. Il se manifeste de manière singulière d’un individu à l’autre. Ceux d’entre nous diagnostiqués tardivement ont souvent dû affronter non seulement les difficultés liées à leur fonctionnement, mais aussi les projections normatives de la société. Ce texte propose d’explorer les types de remarques les plus fréquemment adressées aux personnes autistes, leur impact, et ce qu’elles révèlent en filigrane de notre culture.
I. UNE TYPOLOGIE THÉMATIQUE
a. Sur l’intelligence et la compétence
Les personnes autistes, comme beaucoup d’autres, sont jugées sur leurs capacités intellectuelles. Pourtant, l’autisme ne se résume pas à un retard mental ou à un génie particulier. Il existe une grande diversité parmi les profils autistiques, et bien souvent, les remarques concernant l’intelligence sont teintées d’un condescendant « Tu pourrais faire un effort comme tout le monde ». Ces phrases ignorent que l’autisme n’a rien à voir avec l’intelligence, mais plutôt avec la manière dont une personne traite, comprend et réagit au monde qui l’entoure.
Voici quelques remarques supplémentaires que nous avons collectées, mes connaissances, amis et moi, au cours de notre vie :
« Tu es trop intelligent(e) pour être autiste. »
« Tu comprends vraiment ça ? »
« Tu ne comprends vraiment pas ça ? »
« Tu ne pourrais pas essayer de penser comme tout le monde ? »
Ces jugements ignorent la grande diversité des profils autistiques et enferment les personnes autistes dans une vision binaire et réductrice – l’autiste est génial ou incapable – sans place pour les nuances qui caractérisent la réalité de chaque individu.
b. Sur les émotions et la sociabilité
L’un des stéréotypes les plus tenaces est l’idée que les autistes sont dépourvus d’émotions ou d’empathie. Pourtant, ce n’est pas l’absence d’émotions qui caractérise l’autisme, mais bien une manière différente de les exprimer ou de les percevoir.
Petits florilèges :
« Tu n’as pas d’empathie. » ; « Pourquoi tu serais autiste si tu as de l’empathie ? »
« Pourquoi tu ne souris jamais ? » ; « Pourquoi tu souris si tu es autiste ? »
« Ça ne doit pas être facile pour tes proches. »
« De toutes façons, toi, les autres tu t’en fous. »
« Tu devrais faire des efforts pour être plus spontané. »
Ces saillies trahissent cette incompréhension de l’empathie, qui, chez les autistes, peut se manifester de manière moins conventionnelle mais tout aussi profonde. Les attentes sociales — comme comprendre immédiatement les sous-entendus ou adopter certains codes implicites — ignorent une forme de communication et de compréhension qui peut être tout aussi riche et authentique, mais différente.
Ainsi, au lieu de répondre par un soutien émotionnel traditionnel – une main sur l’épaule, une formule réconfortante – un autiste pourrait offrir des conseils pratiques ou une réflexion logique.
Cette forme d’empathie, bien que différente, reste sincère. Elle trahit simplement une compréhension plus nuancée des émotions, qui, bien que moins conventionnelle, est tout aussi valable et significative.
c. Sur l’autisme en tant que condition
L’une des erreurs les plus fréquentes consiste à minimiser l’autisme, à le réduire à une simple différence qui n’a pas de réel impact.
Quelques exemples encore :
« Tout le monde est un peu autiste, non ? »
« C’est une mode, ce truc d’autisme, comme les HPI. »
« Moi aussi, je n’aime pas les gens parfois. »
Ces remarques, une fois de plus, banalisent l’expérience de l’autisme et effacent les réalités spécifiques auxquelles les autistes sont confrontés au quotidien. Ces propos passent sous silence les défis constants auxquels les autistes sont confrontées : de l’anxiété sociale à la surcharge sensorielle, en passant par les comportements stéréotypés et les difficultés à comprendre ou à exprimer les émotions.
d. Sur le comportement et les particularités
Les comportements atypiques, tels que le « stimming » (comportements répétitifs d’autostimulation comme le battement de mains ou le balancement), sont souvent perçus négativement et peuvent donner naissance à des remarques désagréables et culpabilisantes.
Ces comportements jouent pourtant un rôle essentiel pour les personnes autistes en régulant le déséquilibre sensoriel et en apaisant l’anxiété, particulièrement en situations de stress ou de sur-stimulation. Bien que le stimming puisse sembler étrange ou dérangeant pour ceux qui ne comprennent pas son objectif, il sert de mécanisme d’auto-apaisement, permettant à la personne d’éviter une crise (« meltdown» ou « shutdown »).
Plutôt que de demander à l’individu d’arrêter, il est crucial de reconnaître le stimming comme une réponse adaptative et de mieux comprendre cette particularité comportementale. Des remarques telles que « Tu ne peux pas rester tranquille ? » ou « Tu devrais essayer d’être plus normal(e). » reflètent un rejet de la différence visible, perçue comme une anomalie à corriger, alors que ces comportements sont en réalité des réponses sensorielles ou émotionnelles visant à maintenir un équilibre dans un monde souvent trop intense pour l’autiste, qui tente ainsi de se réguler ou de se sentir en sécurité.
Le stimming permet notamment de libérer l’excès de tension, de canaliser l’anxiété ou de créer un repère sensoriel stable, offrant ainsi une forme d’auto-apaisement dans un environnement perçu comme imprévisible ou envahissant.
Je ne peux m’empêcher de relever que ce comportement est également observé chez les neurotypiques, bien que sous des formes moins évidentes, plus discrètes, et donc plus socialement acceptée dans la culture normative : secouer la jambe ou tapoter des doigts lorsqu’on est nerveux ou concentré ; mâcher du chewing-gum, des bonbons ou même un stylo comme moyen de se détendre ou de se concentrer ; jouer avec les cheveux, les lunettes ou se toucher doucement le visage pendant des moments de réflexion, frapper des pieds ou se balancer légèrement sur une chaise lorsqu’on attend ou réfléchit, cliquer un stylo de manière répétée, souvent dans des moments de stress ou de concentration, se balancer doucement ou se dandiner en attendant dans une file d’attente ou en période d’ennui,….
Ce n’est pas pour autant que nous sommes
« tous un peu autistes ».
e. Culpabilisation et pression sociale
Certaines remarques placent la responsabilité de l’inadéquation sociale sur les épaules des autistes, en leur demandant de s’adapter à un monde conçu par et pour les neurotypiques.
Des phrases comme « Tu dois faire un effort pour t’intégrer. », « Si tu essayais un peu plus, ça irait mieux. » ou « Les autres n’ont pas à s’adapter à toi. » ignorent les efforts colossaux que les autistes doivent déjà fournir pour naviguer dans un monde qui n’est pas pensé pour eux.
Ces remarques font peser une forme de culpabilité sur la personne autiste, sans tenir compte des obstacles réels qu’elle affronte. Par exemple, elle peut passer des heures à analyser les interactions sociales, à imiter des expressions faciales ou des gestes qui ne lui viennent pas naturellement, dans le but d’éviter les « faux pas », tout en luttant contre une surcharge sensorielle permanente qui l’épuise.
De plus, dans un contexte professionnel ou social, l’autiste peut se voir contraint de suivre des normes non écrites, comme maintenir des conversations superficielles ou éviter de montrer des signes de stress, ce qui peut entraîner un épuisement mental et émotionnel. L’exigence de s’adapter, sans reconnaissance de ces défis quotidiens, minimise les efforts considérables déjà fournis et perpétue une vision injuste de l’autisme.
II. CE QUE CES REMARQUES RÉVÈLENT SUR LEURS AUTEURS
Les propos désobligeants à l’égard des autistes ne sont pas simplement des jugements directs sur les individus, mais des révélateurs de certains préjugés, biais cognitifs et insécurités personnelles de ceux qui les prononcent.
a. Ignorance et méconnaissance
Beaucoup de ces remarques découlent d’une profonde méconnaissance de l’autisme. L’autisme demeure une condition entourée de stéréotypes persistants, et une incompréhension des multiples façons dont il peut se manifester conduit, nous l’avons vu, à des jugements simplistes et erronés.
b. Peur de la différence
Les individus peuvent être mal à l’aise avec ce qu’ils ne comprennent pas. L’autisme, en particulier, défie les normes sociales implicites qui régissent nos comportements et interactions. Ainsi, les remarques désobligeantes peuvent souvent traduire une peur de l’inconnu et de la différence.
c. Projection et insécurités personnelles
Les critiques sur le « manque de sociabilité » ou le « manque d’empathie » peuvent parfois masquer des insécurités personnelles.
Par exemple, une personne qui critique un autiste pour son « apparent désintérêt » pour les autres pourrait, en réalité, projeter ses propres difficultés relationnelles ou ses propres frustrations face aux interactions sociales.
d. Rigidité cognitive
Les attentes sociales normatives sont si ancrées dans nos esprits qu’elles deviennent des règles rigides implicites. Tout comportement qui s’en écarte est perçu comme une faute, une anomalie ou un manque de volonté, au lieu d’être vu comme une différence à accepter.
e. Manque d’empathie ou d’ouverture
Enfin, certaines remarques révèlent une incapacité à se mettre à la place de l’autre, à comprendre que des modes de fonctionnement différents peuvent être tout aussi légitimes et valables que ceux des personnes allistes.
III. LES EFFETS PSYCHOLOGIQUES DES REMARQUES DÉSOBLIGEANTES
Les remarques désobligeantes ont un impact profond sur le bien-être des personnes autistes. L’incompréhension sociale, la pression de s’adapter, et l’isolement psychologique généré par ces jugements peuvent mener à des troubles émotionnels comme l’anxiété ou la dépression.
Le phénomène de « masking », où les personnes autistes essaient de cacher leurs particularités pour se conformer, peut entraîner un épuisement émotionnel et une perte de confiance en soi. L’intériorisation de ces critiques peut aussi nuire à l’estime de soi et renforcer des croyances erronées sur l’autisme chez les principaux concernés, créant un cycle de souffrance invisible mais bien réel.
IV. L’AUTISME AU-DELÀ DU SPECTRE CLASSIQUE
L’autisme ne se résume pas aux stéréotypes des comportements spectaculaires. Il existe une multitude de formes d’autisme, et chaque individu a une manière unique de vivre avec cette condition.
Les autistes dits « de haut niveau », souvent diagnostiqués plus tardivement en raison d’une surefficience intellectuelle qui masque et compense partiellement leur trouble du spectre autistique, peuvent mener une vie autonome et avoir un emploi, tout en faisant face à d’importants défis sociaux et émotionnels.
Par ailleurs, certaines personnes autistes peuvent avoir des sensibilités sensorielles très prononcées, des intérêts spécifiques intenses ou des comportements répétitifs, sans pour autant présenter les signes extérieurs que l’on associe généralement à l’autisme.
La société a souvent du mal à comprendre cette diversité, ce qui conduit à des jugements erronés, impactant et dont les conséquences peuvent être, dans certains cas, dramatiques, puisqu’elles peuvent conduire à des suicides.
CONCLUSION
Les remarques désobligeantes adressées aux personnes autistes ne sont jamais neutres. Elles révèlent bien plus sur ceux qui les formulent que sur ceux qu’elles visent : elles traduisent des peurs, des préjugés, une méconnaissance de l’autisme et, plus largement, un imaginaire collectif à transformer.
En déconstruisant ces jugements, en révélant leur portée symbolique, nous ne faisons pas seulement acte de justice envers les personnes autistes, nous interrogeons aussi notre rapport à la norme, à la différence, à ce qui fait l’humain.
Et c’est là, peut-être, que commence une inclusion réelle.