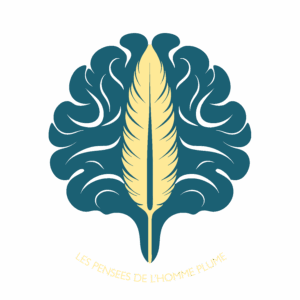L’HYPERSENSIBILITÉ MASCULINE
UNE EXPÉRIENCE PERSONNELLE DE L’INTENSITÉ ÉMOTIONNELLE
Le 23 novembre 2023, j’ai rédigé et publié ce texte sur ma page personnelle, sans savoir que quelques mois plus tard, je recevrais un diagnostic de TSA. Relire ce texte aujourd’hui me semble intéressant. Il reflète la façon dont je vivais mes difficultés à l’époque, avant d’avoir un début d’explication claire pour les comprendre.
A la suite de la publication d’un court texte sur l’hypersensibilité, j’ai reçu quelques messages sur Messenger en provenance de personnes diagnostiquées HPI / TDAH / TSA qui me demandaient si je pouvais écrire quelques mots sur ma propre hypersensibilité, expliquer comment je la vis et si je pense qu’il est problématique pour un homme de vivre une telle intensité émotionnelle dans une société patriarcale où le modèle masculin associe la virilité à une absence totale d’émotions. Le mâle est perçu comme le dominant. Il n’a pas à se préoccuper de sa vie intérieure qui est perçue comme un handicap. Il prend, il se sert, il est roi.
En ce qui me concerne, je me suis senti très tôt en décalage avec la majorité. Celle-ci semblait souvent vivre de manière détachée, voire un peu désintéressée, certaines situations quotidiennes ou en apparence banales, qui, pour ma part, pouvaient provoquer un fort bouleversement intérieur et une intensité émotionnelle quelque peu déstabilisante pour mon entourage et pour moi. Et c’est cet aspect qui est souvent encore difficile à vivre : ce sentiment d’être saisi en permanence par une multitude d’émotions complexes, intenses justement, profondes.
Même les émotions dites positives, confortables, peuvent parfois être compliquées à traverser.
Un animal sauvage croisé sur un chemin, un sourire entre deux inconnus, la beauté fugace d’un ciel d’octobre… tout est matière à un émerveillement presque enfantin chez moi que je ressens dans l’ensemble de mon corps.
De même, les émotions inconfortables, générées par une invective entre deux automobilistes, un animal écrasé sur la route, une personne triste dans un café peuvent me déstabiliser rapidement dans la mesure où j’ai souvent l’impression d’être souvent seul au milieu des autres à remarquer ces moments et m’émouvoir de leur réalité brutale. Et parfois, en plus de ce qui est vécu dans l’instant, je porte en moi pendant plusieurs nuits d’insomnie le souvenir de ces émotions fortes ressenties au cours des jours qui ont précédé.
Je dirais pour synthétiser que, chez moi, quatre problématiques se sont croisées depuis l’enfance, les deux dernières étant le corollaire des deux premières, les quatre s’autoalimentant à l’infini : une dyssynchronie entre les sphères intellectuelle et émotionnelle, une hyper empathie, un état de dissociation presque chronique et la construction d’un faux-self particulièrement peu convainquant pour tenter de me conformer à la norme.
Je vais, tout d’abord, évoquer cette très forte dyssynchronie entre mon intelligence analytique et mon affectivité.
Souvent, chez les enfants précoces, l’intellect est en avance.
La pensée non linéaire, analogique ou en arborescence de certains neuroatypiques leur permet de trouver la bonne réponse de manière quasi-instantanée et il leur est parfois difficile de retrouver le chemin qui les a menés de la problématique à la solution.
Ainsi, souvent, ladite solution avancée est perçue comme étant hors sujet par l’entourage qui en est encore à réfléchir à la question posée. Ces situations peuvent provoquer un fort stress intérieur chez l’enfant précoce, puis chez l’adulte, qui se sent alors incompris, en décalage, voire en sous-efficience intellectuelle.
Dans les cas où cette précocité est reconnue et acceptée, on peut s’attendre à ce que l’enfant réagisse de manière adulte à une situation imprévue.
On lui demande d’avoir un émotionnel qui soit à la hauteur de son intelligence. Pourtant, bien souvent chez ces enfants, si l’intellect est en avance, ce n’est pas le cas de leur émotivité qui est bien celle de leur âge. Dans un cas comme dans l’autre, l’enfant peut être amené à développer une image négative de lui-même, se définissant en tant qu’être instable, incapable de maitriser ses émotions. Ces enfants, si j’en crois les témoignages que j’ai pu collecter depuis que je m’intéresse à ces sujets, sont donc souvent en attente de recevoir des reproches.
Pour ma part, je me suis construit avec l’idée que j’étais toujours « trop » : trop instable pour construire un lien dans la durée, trop intelligent pour être heureux, trop littéraire pour être compris, trop analytique pour être spontané, trop exigeant avec les autres et moi-même, trop perfectionniste, la liste ici est non exhaustive. L’expérience m’a montré qu’elle est fausse.
A cela s’est ajouté une hyper empathie qui a brouillé encore davantage ma compréhension de mon monde émotionnel. En effet, comment arriver déjà à comprendre mes propres émotions, puisqu’elles étaient invalidées par mon proche entourage, alors que je captais en plus les émotions de ceux qui les taisaient également autour de moi ?
Et bien évidemment, quand je posais des questions, l’émotion de l’autre était souvent minimisée par mon interlocuteur : « je ne suis pas triste, je suis juste fatigué » ; « je ne suis pas en colère, je parle juste un peu fort ». Dans les faits, ces émotions, les miennes, celles que je captais chez l’autre, n’étaient pas entendues, reconnues, ni validées. Il m’était donc difficile d’arriver à me comprendre et à comprendre les autres dont les réactions me semblaient souvent déconnectées de la situation vécue, inadaptées et parfois excessives. Quand, par exemple, mon père me hurlait dessus de manière répétée parce que je ne manifestais pas la réaction émotionnelle attendue, cela ajoutait du stress à un stress déjà présent et contribuait activement à augmenter mon inconfort émotionnel.
Pire, cela me renvoyait le message que mes émotions n’étaient pas légitimes et que je ne devais pas les extérioriser. Je me souviens par exemple de la réaction de mon père quand, jeune adulte, je lui avais fait part, en larmes, au téléphone du suicide par balle d’un ami. Je l’entends encore me réponde très sèchement avant de me raccrocher au nez : « Évidemment, chialer va le ramener à la vie ! »
Quelques années plus tard, je deviens enseignant de Français au secondaire II. Un jour, en classe, je remarque qu’une élève avec laquelle j’ai un très bon contact cache une antisèche dans son dictionnaire. L’épreuve vient à peine d’être distribuée. Je lui retire donc le papier qu’elle essaie, prise de panique, d’escamoter maladroitement avant que je ne parvienne à sa hauteur.
Je me souviens lui avoir dit que je le lui confisquais sans lui interdire de faire l’examen qui venait à peine de commencer. En temps normal, j’aurais dû saisir sa copie et lui attribuer la note minimale, la sanction habituelle pour tricherie. C’était une bonne élève au comportement exemplaire et je me suis dit que la leçon que je venais de lui donner préviendrait une récidive. J’avais toutefois ajouté que le rapport de confiance en prenait un sacré coup.
Je n’ai pas compris pourquoi je m’étais subitement retrouvé en état de détresse émotionnelle au moment de quitter l’école quelques heures plus tard. Le soir, je découvre une lettre de 4 pages dans ma boite de réception. L’élève m’y décrit le tsunami d’émotions que ma remarque a déclenché chez elle et me fait part de sa honte de m’avoir déçu.
C’est seulement à cet instant précis, je viens d’avoir trente ans quelques semaines auparavant, que je comprends que les émotions fortes que j’ai ressenties sur le chemin du retour ne m’appartiennent pas, mais sont celles de cette élève.
Une révélation. À partir de là, il m’aura fallu effectuer un travail personnel colossal pour arriver à distinguer les provenances externes ou internes des émotions que je pouvais capter.
Enfant, adolescent, jeune adulte, j’ai tenté d’avancer dans ma vie dans un état de dissociation presque chronique, tellement déconnecté de moi-même. J’essayais de me conformer à ce que je croyais que l’on attendait de moi. Bien sûr, nous portons toutes et tous un masque qui nous permet de nous protéger en société.
Chez le neuroatypique que je suis, pour qui la quête de sens est existentielle, la construction de mon faux-self a creusé davantage la distance que je ressentais avec ce qu’on pourrait appeler la norme. Je comprenais que si je voulais être accepté par le groupe, je devais taire ce qui me distinguait de mes contemporains. Ainsi, pendant des années, je me suis conformé à ce que je croyais être le comportement ad hoc du parfait petit chanteur de rock, ce qui a généré en moi un malaise de plus en plus grandissant, puisque mes diverses addictions de l’époque, bien loin d’étouffer ce qui grondait en moi, exacerbaient cette sensation de décalage constant et rendait plus compliquées encore mes relations avec mon entourage. (Mes amis d’alors avaient d’ailleurs parié sur ma mort. Je ne devais pas atteindre l’âge de trente ans selon eux.)
Mon incompréhension des codes groupaux et, par extension, des codes sociétaux a peu évolué depuis cette époque, puisque j’ai réalisé aujourd’hui que ce que je ne supportais pas, c’était l’hypocrisie des différents rôles que je pouvais (très mal) incarner (le séducteur, le compétiteur, le dominant) qui empêchait la rencontre authentique avec l’autre. Je les voyais, ces autres, jouer tous ces personnages et, comme beaucoup de neuroatypiques, j’essayais de m’intégrer en imitant les comportements que je remarquais autour de moi. Évidemment, une fois seul, je traversais des décompensations particulièrement violentes.
Pour parvenir à démêler mes fonctionnements, il m’aura fallu m’intéresser au vrai sens des émotions et aux besoins et limites qui se cachent derrière.
Mais, quand on est neuroatypique, rien n’est simple. Il ne me suffisait pas de décoder mon affectivité pour arriver à mieux la vivre puisque je peux passer par des changements d’humeurs aussi profonds, brusques, complexes, ambivalents que déroutants (pour moi, mais aussi pour mes proches). Et comme la cyclothymie est un mélange de trois pôles distincts : l’énergie, les pensées et l’humeur, je peux parfois me surprendre à être dans des états complètement paradoxaux et quasiment impossibles à décrire pour mon entourage : je peux, par exemple, me retrouver dans un état d’épuisement, avoir les idées claires et être totalement euphorique.
Ou comme dirait le renard de « Goupil ou face » l’excellente bande dessinée de Lou Lubie sur la cyclothymie : « Oh, un tirage original ! Tu vas être à la fois sereine, confuse et agitée. » Et son interlocutrice, accablée, de lui répondre : « … ça n’existe pas comme émotion. Comment vais-je expliquer ça à mon compagnon ? »
Dans mon cas, j’ai été, tellement habitué à vivre des émotions extrêmes, que lorsque je suis dans des espaces peu stimulants, il me faut quelque temps pour comprendre que je ne traverse pas un état d’anémie émotionnelle. Mes curseurs sont simplement un peu plus ajustés.
Le problème, c’est qu’il y a chez moi une forme d’addiction à ces ressentis profonds qui est certainement la cause de mon hyperactivité (rencontrer de nouvelles personnes, lancer mille projets, m’intéresser à un milliard de choses…) que j’apprends à calmer en privilégiant des moments plus contemplatifs, car oui, je suis un contemplatif hyperactif, l’un de mes paradoxes.
Quoi qu’il en soit, j’ai toujours dû passer de nombreuses heures à l’écart des autres, pour recharger mes batteries, trier les émotions de la journée, déconstruire, puis saisir ce qui s’est animé en moi. Parfois, mon besoin d’intensité a pu me faire oublier cette nécessité de me ménager des moments de repos, contribuant à m’épuiser plus que de raison.
Ce qui m’a permis d’arriver à mieux vivre cette affectivité, c’est la psychothérapie que je suis depuis trois ans. Évidemment, le choix du spécialiste est d’une importance capitale, puisqu’il est là pour accompagner, guider, ouvrir des espaces de réflexion, aider à se décoder, libérer ce qu’il y a à libérer. Guérir.
Plus je me comprends, plus je comprends mon mode d’emploi interne, plus je maitrise ma cyclothymie et l’intensité de mon univers intérieur.
Quant à la question de savoir ce que c’est d’être un homme à la vie émotionnelle dense dans un monde patriarcal ? Très franchement, je ne peux pas dire si je me la suis sérieusement posée un jour.
Je suis sincèrement convaincu que nous ne pouvons vivre en harmonie que si nous arrivons à concilier nos polarités féminine et masculine. Prétendre que seules les femmes sont légitimes dans l’expression de leurs émotions, c’est accepter le conditionnement sociétal qui nous limite dans notre quête d’individuation. L’hypersensibilité n’est pas synonyme de sensiblerie. Elle permet de ressentir pleinement le monde dans toutes ses nuances, sa complexité et sa richesse.
Et, pour moi, c’est reconnaître, expérimenter, mais surtout honorer, la grande force du vivant.