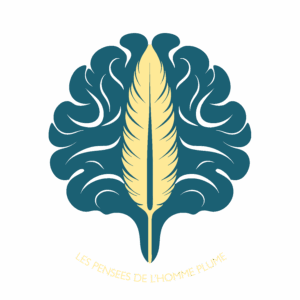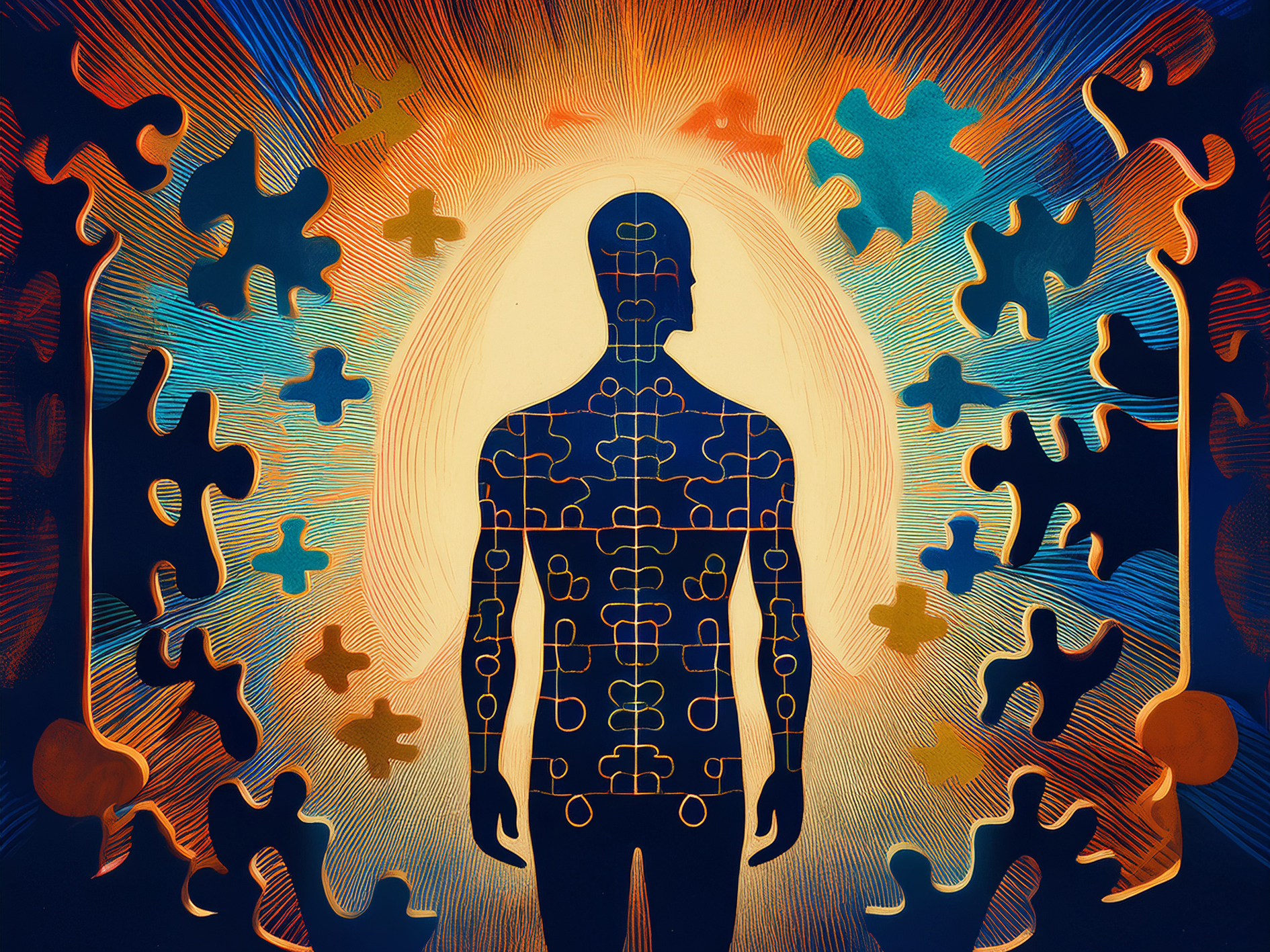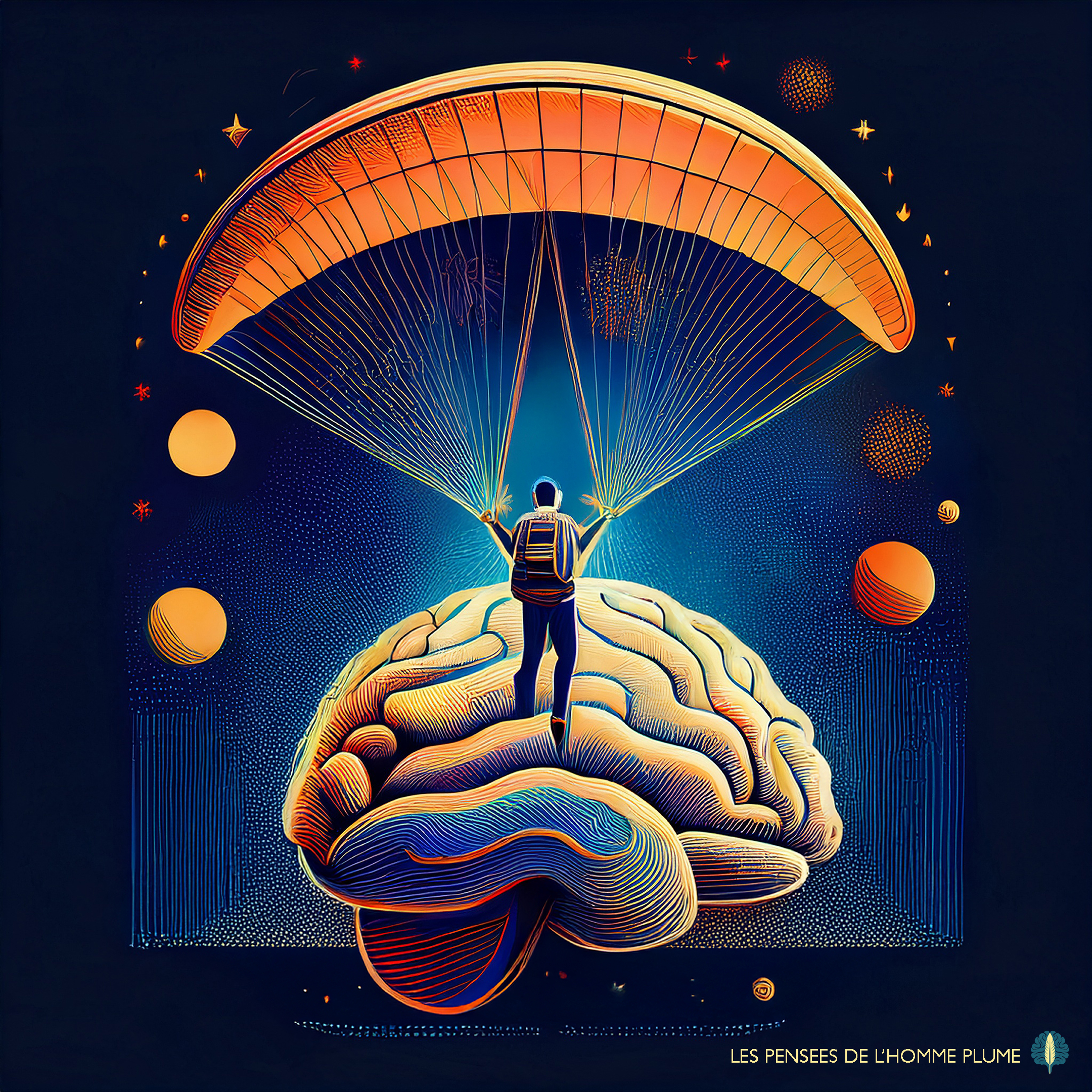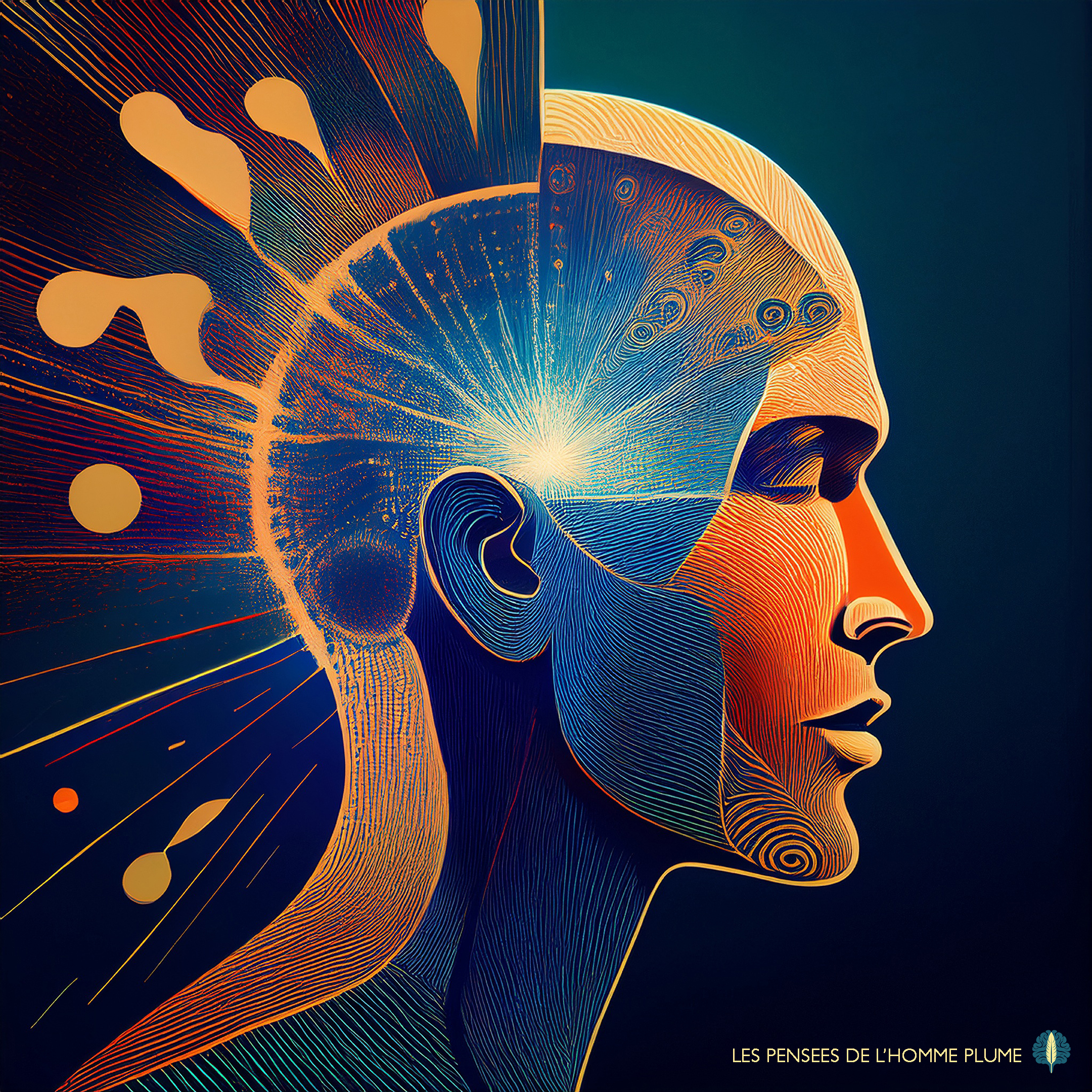NEURODIVERGENCE ET CONSTRUCTION DU SUJET
Approches réflexives autour de l’autisme, de la perception, des temporalités et des mécanismes de régulation.
Cette rubrique explore comment l’expérience autistique et d’autres formes diverses de neurodivergence influencent la manière dont une personne se perçoit, se définit et évolue au fil du temps.Elle aborde la singularité sensorielle, la relation au temps et les stratégies de régulation, avec une attention soutenue aux processus internes qui façonnent l’identité et le rapport au monde.
Cliquez sur l’image pour accéder à l’article
Un acte de vérité dans une société validiste
Résumé de l’article
Accepter d’être soi dans une société normée, c’est choisir la vérité plutôt que la conformité.
Pour les personnes autistes, ce chemin passe souvent par un écroulement, une remise en question radicale du masque social imposé dès l’enfance.
Retirer ce masque coûte cher, mais c’est le prix d’une liberté intérieure réelle, celle de ne plus se trahir.
Dans une société validiste, être soi n’est pas seulement un acte personnel : c’est un positionnement politique.
Refuser les normes capacitistes, créer des espaces sûrs, affirmer une culture autistique, c’est résister à une hiérarchie implicite des fonctionnements humains.
Être pleinement soi, sans excuses, c’est déjà élargir le monde.
Une esthétique de la présence
Résumé de l’article
Chez certaines personnes autistes, l’émerveillement ne se manifeste pas de façon ponctuelle ou circonstancielle, mais comme un état perceptif quasi permanent.
Il ne s’agit pas d’un enchantement naïf, mais d’un rapport au monde profondément sensoriel, précis et souvent ineffable.
Tout devient susceptible de générer de l’émerveillement : la façon dont la lumière rebondit sur une surface, les modulations infimes d’une voix, le mouvement d’un animal, la texture d’un silence.
Cette hypersensibilité sensorielle, souvent présentée comme une entrave, ouvre en réalité sur un registre de perception d’une densité particulière.
Là où le monde dit « neurotypique » filtre, trie et hiérarchise, l’esprit autistique capte, enregistre, s’émerveille.
Rien n’est trop petit, trop insignifiant ou trop banal : tout mérite attention.
L’émerveillement devient alors une forme de résistance à l’indifférence, une manière d’habiter le monde avec intensité.
Croyances, cadre et confusion identitaire
Résumé de l’article
La rupture brutale du lien, sans conflit explicite, révèle une difficulté sur le plan intersubjectif : la perception qu’a la personne TSA de l’autre devient biaisée par des mécanismes de protection.
Ce phénomène traduit une hypersensibilité au cadre relationnel et une rigidité identitaire, où toute incertitude ou ambiguïté est perçue comme une menace.
La rupture brutale du lien, sans conflit explicite, révèle une difficulté sur le plan intersubjectif : la perception qu’a la personne TSA de l’autre devient biaisée par des mécanismes de protection.
Ainsi, ces ruptures ne sont pas des rejets personnels, mais des réponses protectrices face à une réalité relationnelle jugée instable.
Comprendre cette dynamique ouvre la voie à une meilleure communication et à des liens plus souples, fondés sur la reconnaissance mutuelle des besoins et limites.
Un miroir des normes et des peurs sociales
Résumé de l’article
Les remarques désobligeantes envers les personnes autistes — souvent perçues comme anodines — révèlent en réalité des préjugés profonds : « Tout le monde est un peu autiste », « Tu es trop intelligent pour être autiste », « Tu as de l’empathie, donc tu ne l’es pas », .
Ces phrases, répétées à l’usure, minimisent notre vécu, invisibilisent nos efforts d’adaptation et renforcent l’idée qu’il faudrait coller à une norme pour être accepté.
Derrière ces jugements, on retrouve une peur de l’altérité, une ignorance des réalités autistiques, et une difficulté collective à tolérer ce qui déroge aux codes implicites.
Pourtant, l’autisme n’est ni une maladie ni un défaut à corriger : c’est une autre manière de percevoir et d’habiter le monde.
Déconstruire ces remarques, c’est ouvrir la voie à une inclusion réelle — une inclusion qui commence par la reconnaissance des différences, et non leur effacement.
Vers une écologie des rythmes autistiques
Résumé de l’article
Et si notre rapport au temps n’était pas universel, mais profondément normé ?
Pour les personnes TSA-SDI ou HPI, le temps dominant – linéaire, rapide, optimisé – devient souvent un carcan.
Leur rapport au temps est autre : sensoriel, incarné, dense.
Il ne s’agit pas d’un déficit, mais d’un rythme minoritaire, vital, souvent incompris.
Ce texte invite à reconnaître la richesse des temporalités atypiques : entre immersion, hyperfocus, lenteur ou anticipation, ces rythmes révèlent une écologie du temps plus vivante et plus juste.
Résister aux cadences imposées devient alors un acte d’insoumission sensible, et une voie vers une société réellement inclusive.
Une plongée au cœur du meltdown autistique
Résumé de l’article
J’ai récemment traversé un meltdown autistique, le premier depuis quatre ans et depuis le diagnostic de mon TSA.
Ce phénomène neurophysiologique, résultant d’une surcharge émotionnelle et sensorielle, n’est ni une crise de colère ni un comportement volontaire, mais une défaillance temporaire du système nerveux central, révélant une incapacité à gérer un stress extrême.
Ce meltdown a réactivé des traumatismes d’enfance liés à un environnement familial violent, où des mécanismes de survie, tels que les comportements auto-agressifs, ont été développés.
Ces comportements, loin d’être pathologiques, constituent des stratégies adaptatives visant à réguler une douleur intense et à maintenir un certain contrôle face à une détresse profonde.