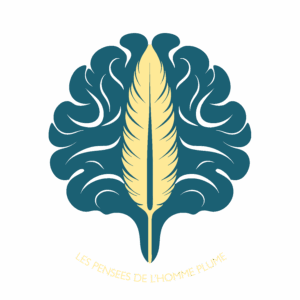SEXUALITÉ ET AUTISME
DÉPASSER LES CLICHÉS, ACCUEILLIR LA SENSORIALITÉ
I. UNE PORTE OUVERTE SUR LA SENSORIALITÉ
AU-DELÀ DES CLICHÉS
I.1. INTRODUCTION
La sexualité ne se limite pas à un simple processus biologique ou reproductif : elle touche aux sensations, aux émotions, aux liens et à l’identité.
Chez de nombreuses personnes concernées par le spectre de l’autisme, elle occupe souvent une place centrale dans la façon de vivre l’intimité.
Pourtant, lorsqu’il s’agit de cette population, cette dimension reste souvent mal comprise, ignorée, contestée, voire niée. La société tend à l’infantiliser, à la priver symboliquement de sa vie intime, ou à nier son droit à une vie sexuelle digne et épanouie.
Or, une étude, Sexual and Relationship Interest, Knowledge, and Experiences Among Adolescents and Young Adults with Autism Spectrum Disorder, a contribué à bousculer ces idées reçues, puisqu’elle démontre que de nombreux jeunes autistes manifestent un réel intérêt pour la sexualité et les relations affectives.
Comme tout un chacun — est-il vraiment légitime de s’en étonner ? — ils ressentent du désir, se posent des questions identitaires (car la construction de soi passe aussi par la reconnaissance et l’intégration de ces désirs), et vivent des émotions fortes, complexes, souvent entremêlées.
Cette recherche met également en lumière des frustrations profondes, liées à un manque d’informations adaptées et à des difficultés d’ordre relationnel. Les obstacles à l’accès à l’intimité sont souvent renforcés par les défis sensoriels et sociaux propres au spectre autistique.
Par ailleurs, la plupart des travaux sur la sexualité des jeunes autistes s’appuient encore majoritairement sur les témoignages de parents ou de professionnels. Cette approche introduit un biais : la nature intime du sujet conduit souvent les jeunes à taire certaines expériences face à leurs proches (Coskun & Mukaddes, 2008 ; Dozier et al., 2011). Quelques études récentes ont commencé à donner la parole aux personnes concernées elles-mêmes (Kellaher, 2015 ; Pecora et al., 2016), mais ces travaux portent surtout sur des adultes, et rarement sur des adolescents ou de jeunes adultes.
On note également un déséquilibre de genre dans la littérature scientifique : la majorité des données disponibles concernent les hommes autistes, tandis que les vécus spécifiques des femmes restent encore largement sous-explorés (Byers et al., 2013 ; Dewinter et al., 2015).
Pour rédiger ce texte, je me suis principalement appuyé sur les travaux d’Isabelle Hénault, psychologue et sexologue, directrice de la Clinique Autisme et Asperger de Montréal. Elle fait partie des rares spécialistes à avoir vraiment exploré la sexualité des personnes autistes. Titulaire d’une maîtrise en sexologie et d’un doctorat en psychologie, elle a développé une solide expertise dans l’accompagnement des personnes Asperger et dans l’étude des relations affectives et sexuelles, notamment à travers de nombreux projets de recherche internationaux.
Partant de ces apports fondamentaux, j’ai choisi de circonscrire ma réflexion autour d’un aspect central : la sensorialité, considérée comme l’un des principaux modulateurs de la sexualité chez ces personnes. Plusieurs textes en lien sur ce sujet sont, par ailleurs, en gestation.
J’ai le projet de consacrer un texte à chacun de nos huit sens — interoception, proprioception et système vestibulaire inclus — afin d’explorer plus finement la manière dont chacun façonne l’expérience intime et relationnelle.
Toutefois, je ne pouvais pas faire l’impasse sur les difficultés concrètes que rencontrent les personnes autistes dans la construction de leur vie affective et sexuelle, ni sur l’importance de déconstruire les clichés qui les entourent — un travail qui fait pleinement partie des raisons d’être de ce blog.
I. 2. DÉCONSTRUIRE LES CLICHÉS
L’un des préjugés les plus tenaces consiste à penser que les personnes autistes seraient dépourvues de désir ou d’intérêt pour les relations intimes.
Cette idée, évidemment fausse, absurde et déshumanisante (un terme fort, mais fidèle à une réalité brutale), ne résiste pas à l’épreuve des faits. S’il est établi sur le plan clinique que l’autisme peut rendre certaines interactions sociales plus complexes, cela n’implique en rien une absence d’émotions, de sentiments ou d’intérêt pour la sexualité.
De nombreuses personnes autistes éprouvent un besoin d’attachement, cherchent à aimer et à être aimées, et expriment une sexualité parfois intense — souvent traversée par des formes d’expression singulières, en décalage avec les normes sociales. Ce décalage peut se manifester par des préférences spécifiques en matière de contacts physiques : certaines personnes privilégient un toucher léger et doux, tandis que d’autres recherchent des stimulations tactiles plus profondes ou répétitives qui les apaisent.
D’autres encore peuvent être sensibles à certains types de contact, comme les baisers ou le peau contre peau, qui peuvent provoquer inconfort ou douleur.
Dans certains cas, ces tensions corporelles et psychiques peuvent se traduire par des symptômes psychosomatiques, tels que des vaginites, reconnus dans la littérature médicale comme des manifestations somatiques liées à une détresse émotionnelle intense (Carson, 1978). Dans le cadre de mes échanges avec des femmes autistes, il m’a été rapporté que certaines ont développé de tels symptômes, qui semblent traduire une peur intense d’être envahies ou contrôlées par leur partenaire masculin. Ce phénomène peut parfois refléter une réaction inconsciente liée à la peur du viol ou de la violence sexuelle, un thème qui sera approfondi dans un texte ultérieur, en cours d’écriture.
Un autre malentendu réside dans l’idée que leur sexualité serait « mécanique » ou « sans affect ». Cette perception validiste erronée occulte une fois encore la richesse intérieure et la sensibilité des vécus autistiques. Là où certaines personnes peuvent exprimer leurs désirs de manière plus directe, d’autres utilisent des codes différents, parfois moins lisibles, mais tout aussi chargés de sens. La sexualité autistique est bien présente, profondément incarnée, souvent subtile, et se manifeste de manière singulière.
Enfin, la croyance selon laquelle les personnes autistes seraient nécessairement vulnérables, naïves ou inaptes à faire des choix éclairés peut conduire à une posture de surprotection. Sous couvert de bienveillance, cette attitude infantilise, mais surtout invisibilise, car elle nie la capacité des personnes concernées à consentir, à poser leurs limites, à explorer leurs envies et à définir ce qui est bon pour elles.
I.3. LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Même lorsque le désir est présent, les personnes autistes se heurtent souvent à des obstacles structurels et sociaux dans l’expression de leur vie intime. Décoder les codes implicites de la séduction, comprendre les silences de l’intimité, et appréhender les subtilités de la communication sexuelle représentent souvent un véritable défi. Les malentendus sont nombreux, et peuvent engendrer un sentiment violent d’échec, de solitude, voire de rejet.
L’éducation sexuelle, lorsqu’elle existe, est rarement pensée pour inclure les besoins spécifiques des personnes neurodivergentes. Les messages sont souvent flous et les généralisations hâtives. Les contenus, généralement survolés, empêchent une réelle appropriation.
Les personnes autistes ont besoin de pédagogies explicites, concrètes, visuelles et répétées, qui respectent leur manière singulière d’apprendre et d’appréhender le monde.
Comme le rappellent plusieurs travaux (Dewinter et al., 2017 ; Mehzabin & Stokes, 2011; Pecora, Mesibov & Stokes, 2016), les difficultés de communication et le manque de conscience sociale propre à l’autisme peuvent rendre l’établissement et le maintien de relations amoureuses, intimes ou sexuelles particulièrement complexes.
Le système scolaire, en ce sens, échoue bien souvent à fournir des apprentissages concrets en matière d’habiletés sociales et de sexualité (Hatton & Tector, 2010 ; Sperry & Mesibov, 2005 ; Tullis & Zangrillo, 2013).
Ces lacunes éducatives peuvent avoir des répercussions importantes.
Certaines personnes autistes, faute d’informations claires ou d’espace sécurisé pour poser leurs questions, peuvent adopter des comportements perçus comme inappropriés ou mal ajustés. Par exemple, elles peuvent interpréter littéralement des phrases ambiguës ou des sous-entendus, ce qui entraîne parfois des réactions jugées décalées.
De plus, le manque de connaissance des normes relationnelles peut rendre difficile l’initiation d’un contact affectif ou sexuel, ainsi que la compréhension des règles implicites du flirt ou de la séduction.
Il est important de noter également que les personnes autistes, y compris celles qui sont non-binaires ou transgenres, sont également surexposées au risque de subir des violences sexuelles — un phénomène particulièrement préoccupant chez les adolescentes et jeunes femmes autistes, dont les taux de victimisation, estimés à 88 %, sont bien plus élevés que dans la population générale (Coskun & Mukaddes, 2008 ; Ruble & Dalrymple, 1993 ; Gourion et al., 2019).
Cette surreprésentation concerne aussi les jeunes personnes transgenres et non-binaires sur le spectre, qui cumulent souvent les facteurs de vulnérabilité liés à leur neurodivergence et à la transphobie ou à la non-conformité de genre. Parmi les victimes, 51 % ont été soumises à des pénétrations sous contrainte, et 39 % ont déclaré avoir été violées. Cette étude souligne également que 47 % d’entre elles ont subi leur première violence avant l’âge de 14 ans, et 31 % avant 9 ans.
À ces dimensions sociales s’ajoute la question, souvent négligée, de la sensorialité — un aspect central de l’expérience sexuelle chez les personnes autistes. Certaines stimulations corporelles, comme évoqué plus haut, peuvent être perçues comme envahissantes, douloureuses, voire agressives, tandis que d’autres suscitent un plaisir intense, parfois inattendu, notamment chez les personnes synesthètes (un sujet qui mériterait à lui seul un développement ultérieur). Dans ce contexte, l’exploration de soi, du corps et du contact exige du temps, un cadre véritablement sécurisant, ainsi qu’une écoute fine et constante des limites personnelles.
Enfin, le regard social, souvent teinté de paternalisme, de condescendance et d’incompréhension, renforce le sentiment d’isolement. Le poids des normes sexuelles hétérocentrées, performatives et neurotypiques peut rendre difficile l’expression libre du désir.
Beaucoup de personnes autistes intériorisent alors l’idée qu’elles ne sont « pas faites » pour les relations, ou qu’elles doivent se conformer à des scénarios qui ne leur ressemblent pas, voire renoncer à leur vie sexuelle.
Dans ce contexte, certaines personnes peuvent s’identifier comme asexuelles ou demisexuelles, non pas par absence de désir intrinsèque, mais parce que le contexte social et sensoriel rend l’accès au désir trop chargé d’insécurité ou de malaise.
D’autres, au contraire, découvrent ces orientations comme des clés d’acceptation et de compréhension de soi, leur permettant d’habiter leur expérience relationnelle de manière à respecter leurs propres rythmes.
I.4. SENSORIALITÉ, DÉSIR ET PLEINE PRÉSENCE
L’une des voies les plus éclairantes pour comprendre la sexualité autistique réside dans l’exploration de sa dimension sensorielle. Plutôt que d’une sexualité absente, froide ou anormale, il s’agit souvent d’une sexualité incarnée autrement — attentive, immersive, et profondément enracinée dans l’expérience corporelle.
Les sensations tactiles, visuelles, auditives, olfactives, gustatives, vestibulaires, proprioceptives ou intéroceptives peuvent avoir une intensité particulière chez les personnes autistes. Certaines stimulations sont perçues comme violentes, d’autres comme extraordinairement enveloppantes. Ces différences ne relèvent pas de simples préférences : elles façonnent en profondeur la manière d’entrer en lien avec son propre corps, avec autrui, avec le monde.
Un effleurement peut être insupportable, un son trop aigu peut interrompre toute possibilité d’excitation, une texture désagréable peut court-circuiter l’élan du désir. À l’inverse, certains stimuli sensoriels — une pression contenue, une odeur rassurante, une rythmique particulière — peuvent susciter un apaisement profond, voire une forme d’extase. C’est dans cette sensibilité accrue au monde que s’ouvre une autre forme de désir : moins tournée vers la performance ou la norme, et plus orientée vers la rencontre sensible avec soi-même et avec l’autre.
Ce lien étroit à la perception immédiate permet, pour certaines personnes autistes, une sexualité centrée sur la présence — une qualité d’écoute et d’attention qui transforme chaque contact en une exploration lente, riche et consciente. Une danse entre les sens, où chaque geste, chaque souffle, chaque texture devient porteuse de signification.
Là où la société valorise la rapidité, la performance ou les codes implicites de la séduction, la sexualité autistique peut, au contraire, s’ouvrir comme un espace de présence, de lenteur et d’authenticité.
Comme le souligne l’étude de Gray et al. (2021), ces caractéristiques sensorielles influencent de manière déterminante les pratiques sexuelles des adultes autistes. Il n’est pas rare que la masturbation, perçue comme plus contrôlable et prévisible, soit privilégiée à certains moments. D’autres préfèrent des environnements très maîtrisés, où les paramètres sensoriels sont choisis avec soin.
La reconnaissance de ces particularités permettrait d’ouvrir la voie à une éducation sexuelle plus juste, plus attentive, véritablement respectueuse et réellement adaptée aux réalités des personnes autistes.
Pour cela, il est esentiel que les professionnels de la santé, de l’éducation ou de l’accompagnement soient formés à ces enjeux, afin d’accueillir sans jugement, sans projection, et sans chercher à normaliser ce qui relève simplement d’une autre manière de ressentir et de se relier au monde — une façon d’être souvent en décalage avec les conceptions performatives de la sexualité véhiculées par nos sociétés validistes, consuméristes – où l’humain devient lui-même un bien consommable – et patriarcales.
Et revenir à une compréhension incarnée de la sexualité, mais surtout de l’intimité charnelle, afin de transformer cet espace de rencontre en un acte de célébration du vivant.
Ce qui demande de la confiance et du courage.
II – RETROUVER UN CHEMIN VERS LE CORPS
II.1. INTRODUCTION
Chez certaines femmes autistes ou hypersensibles, la sexualité s’apparente à un territoire complexe, souvent chargé d’une multitude d’ombres plus que de traumatismes explicites. Il s’agit davantage de zones floues, de silences profonds et d’injonctions intériorisées.
Nombre d’entre elles ont grandi dans l’absence de repères clairs quant à ce qu’elles avaient le droit de ressentir, de vouloir ou de refuser. Le corps, loin d’être simplement un véhicule, devient un espace où se mêlent confusion, attentes externes et difficultés à percevoir ses propres signaux.
Dans ce cadre, la sexualité cesse d’être un simple acte ou une fonction biologique : elle s’inscrit alors comme un chemin de reconnexion à soi, un processus délicat, patient, fait d’expérimentations, de doutes et de réajustements.
C’est dans cet espace que se déploie la nécessité vitale de désamorcer les scripts dominants — performance, linéarité, pénétration comme passage obligé — pour permettre l’émergence d’une sexualité réparatrice, sensorielle et pleinement consciente.
II.2. UNE RELATION AU CORPS SOUVENT AMBIGUË, JAMAIS ABSENTE
Lorsque certaines femmes confient : « Je ne sais pas ce que je souhaite » ou « Je ne sais pas ce qui est acceptable ou non », il ne s’agit nullement d’un désintérêt pour l’intimité.
Ces interrogations révèlent souvent une relation distanciée, parfois héritée d’une socialisation confuse, d’un environnement émotionnel peu sécurisant, ou d’expériences relationnelles ambiguës.
Chez beaucoup, cette ambiguïté peut naître d’une absence de validation dans l’enfance : leurs ressentis ont été ignorés, leur espace personnel non respecté. D’autres ont développé une forme de dissociation, un éloignement subtil d’elles-mêmes, qui rend difficile l’écoute de leurs signaux corporels.
Pourtant, dans un cadre sécurisant, leur corps peut réapprendre à guider : un toucher juste, un contact spontané, un frisson silencieux deviennent autant de boussoles intérieures, intimes et instinctives, porteuses d’une sagesse précieuse.
II.3. DES SCHÉMAS INTÉRIORISÉS QUI ENTRAVENT L’ÉCOUTE DE SOI
La construction de la sexualité féminine autiste s’inscrit fréquemment dans une triple contrainte socioculturelle : une socialisation patriarcale valorisant conformité, douceur et disponibilité ; une invisibilisation des besoins spécifiques neurodivergents, sensoriels et relationnels ; une pression hétéronormée imposant des scripts rigides — préliminaires, pénétration, orgasme.
Ce cadre produit des femmes qui savent très précisément ce que la société attend d’elles, mais ignorent souvent ce qu’elles désirent pour elles-mêmes. Elles ont appris à ne pas dire non — ou à le faire trop tard. Elles ont développé des stratégies de camouflage affectif et sexuel qui, paradoxalement, les déconnectent de leur propre expérience.
Lorsqu’elles aspirent à une sexualité incarnée, ces femmes se retrouvent souvent démunies, sans langage pour nommer leurs ressentis, sans modèle auquel se référer, ni carte pour s’orienter dans ce territoire intime. Cette absence de repères rend l’exploration difficile, amplifiant le sentiment d’isolement face à un vécu encore largement méconnu et incompris.
II. 4. LE CONSENTEMENT, UNE PRÉSENCE VIVANTE,
NON UNE FORMALITÉ
Il importe de reconnaître que le consentement n’est pas une donnée figée, mais une expérience dynamique, sensorielle et changeante. Un « oui » exprimé à un moment précis peut évoluer en un « je ne sais plus », voire en un refus quelques instants plus tard. De la même manière, un « non » ne ferme pas forcément la porte : il peut ouvrir un espace de curiosité douce, lorsqu’il est accueilli sans jugement ni pression.
Ainis, un refus initial, respecté sans jugement, peut évoluer avec la confiance. Peu à peu, la personne peut s’ouvrir à une exploration nouvelle, à son rythme, montrant que le consentement est un processus vivant, flexible et éclairé.
Pour autant, et ce point est essentiel : le consentement véritable n’est pas une case à cocher, mais un mouvement vivant, sensible et réajustable, qui exige : la capacité de percevoir ses propres signaux (ce qui demande parfois un long apprentissage) ; la liberté de changer d’avis sans culpabilité ; la présence d’un partenaire capable d’entendre les silences, les hésitations, les retraits sans s’en formaliser.
C’est en acceptant cette fluidité que l’on prévient bien des disjonctions émotionnelles ou sensorielles. Plus encore, c’est en créant cet espace que l’intimité cesse d’être source d’angoisse pour devenir un terrain d’exploration.
II. 5. PISTES CONCRÈTES DE RECONNEXION POUR REVENIR AU CORPS
Réhabiter son corps exige du temps et, souvent, un premier travail solitaire.
Parmi les chemins possibles vers cette reconnexion, il peut être précieux de tenir un journal intime des sensations — un espace où consigner ce qui apaise, ce qui procure confort, ainsi que les types de contact qui résonnent véritablement.
S’ouvrir à l’exploration de ses propres ressentis, en dehors de toute dimension sexuelle ou performative, permet de renouer avec la matière vive du corps.
Retrouver le toucher dans sa simplicité non sexuelle, la douceur de la lenteur, la richesse silencieuse d’une présence partagée — être côte à côte, peau contre peau, sans attentes ni contraintes — ouvre un territoire de confiance.
Il s’agit aussi d’instituer, avec un partenaire, des rituels empreints de douceur et de respect : poser les mains, synchroniser la respiration, accueillir ensemble ce qui est là, dans une posture d’acceptation bienveillante, exempte de jugement ou de demande.
Ces moments deviennent alors de véritables instants de reconnexion, où le corps cesse de devoir « faire » ou « réussir » pour simplement s’exprimer et se faire entendre. C’est dans cette présence calme et respectueuse que naît une forme d’harmonie intime, fondée sur le respect mutuel et une sensorialité partagée,
C’est au travers de ces micro-expériences que renaît, à mon sens, l’écoute de soi — non comme une quête de performance, mais comme l’expression d’une présence paisible et authentique.
II. 6. ACCOMPAGNER SANS IMPOSER
Pour celle ou celui qui accompagne une personne autiste ou hypersensible sur ce chemin, il ne s’agit ni de guider ni de protéger, mais d’offrir un soutien empreint de confiance à l’exploration.
Cela requiert : l’absence d’attentes fixes ou prédéfinies ; la valorisation de chaque pas de présence, même lorsque ceux-ci ne débouchent pas sur une expérience explicitement sexuelle ; la capacité de se retirer avec douceur face à un recul ou une mise en retrait ; l’accueil sincère et respectueux de la parole, du silence ou de la gêne, reconnus comme autant de messages légitimes.
Accepter que l’autre puisse dire non à tout moment, que l’exploration s’interrompe ou change de cap, est une manifestation profonde d’amour.
Loin d’être un abandon, cette acceptation est au contraire le socle véritable d’une intimité partagée et respectueuse.
II. 7. VERS UNE SEXUALITÉ LIBRE, SENSORIELLE ET SACRÉE
La sexualité est trop souvent cantonnée à un parcours normatif et balisé : excitation, pénétration, orgasme. Ce modèle, profondément validiste et hétéronormé, se révèle souvent étouffant, voire violent, pour de nombreuses personnes autistes.
Pour retrouver un sens véritable, il convient de se libérer de cette logique prescriptive : refuser la course effrénée à la jouissance ; accueillir l’idée que le but n’est pas nécessairement de « faire l’amour », mais d’entrer en rencontre authentique ; s’autoriser à rire, à expérimenter, à renoncer, à accepter l’incertitude.
La sexualité, dans sa vitalité, peut revêtir mille formes : une main doucement posée, un souffle partagé, une étreinte silencieuse, une exploration mutuelle sans mots ni dessein précis. C’est dans cet espace de liberté que se tissent des expériences à la fois réparatrices, sensuelles et sacrées.
II. 8. ET LES HOMMES AUTISTES ?
Si ce texte met l’accent sur la sexualité féminine, particulièrement façonnée par des normes patriarcales et validistes, il est essentiel de reconnaître que de nombreux hommes autistes vivent des difficultés similaires : difficulté à identifier leurs désirs et leurs limites ; pression à la performance sexuelle ressentie comme un lourd fardeau ; déconnexion corporelle ou, à l’inverse, hyperstimulation sensorielle envahissante.
Intégrer ces expériences dans la compréhension globale de la sexualité autistique ouvre la voie à une norme élargie, qui ne se contente pas de reproduire les modèles dominants sous une autre forme.
L’enjeu n’est pas d’opposer ces vécus, mais d’inviter chacune et chacun à honorer avec dignité sa propre vérité corporelle.
II. 9. UNE SEXUALITÉ RÉPARATRICE EST UNE SEXUALITÉ VRAIE
Pour une personne autiste, retrouver une sexualité incarnée revient souvent à désapprendre avant d’apprendre.
C’est oser dire « je ne sais pas », « je ne suis pas sûre », « je ne veux plus ».
C’est redonner au corps un droit de parole et offrir à l’intimité un véritable espace de présence.
Cela n’a rien d’un échec ; c’est, au contraire, un chemin d’affirmation de la souveraineté sensorielle, de dignité et de confiance. C’est là, où le consentement se fait écoute vivante, où la performance s’efface au profit de la relation, qu’émerge une sexualité véritablement libre — une sexualité sacrée, au sens le plus humain et lumineux du terme.
Par « humain », j’entends cette expérience profondément ancrée dans notre nature complexe, vulnérable et relationnelle, où la sexualité devient une source d’authenticité et de lien vrai, au-delà des normes et des attentes. Par « lumineux », je souligne la dimension apaisante, claire et réparatrice de cette sexualité vécue dans la conscience et la confiance — une lumière intérieure qui éclaire le chemin vers une présence pleine, joyeuse et sensée.
C’est ainsi que se construit, pas à pas, une intimité où toute personne peut pleinement se reconnaître, s’accepter dans sa singularité, et s’épanouir en toute liberté.
Voilà, en tous les cas, le souhait le plus profond que je forme pour vous.
III. BIBLIOGRAPHIE
III.1. GÉNÉRALITÉS ET APPROCHES CLINIQUES
III. 2. ÉTUDES EMPIRIQUES SUR LES RELATIONS, LA SATISFACTION ET L’ÉDUCATION SEXUELLE
III.3. SENSORIALITÉ ET SEXUALITÉ
III. 4. IDENTITÉ, GENRE ET DIFFÉRENCE SEXUELLE
III. 5. TÉMOIGNAGES, RÉCITS ET SUBJECTIVITÉ AUTISTIQUE
III. 6. FONCTIONS SEXUELLES ET SANTE SEXUELLE
III.7. VIOLENCES SEXUELLES ET VULNÉRABILITÉ SPÉCIFIQUES